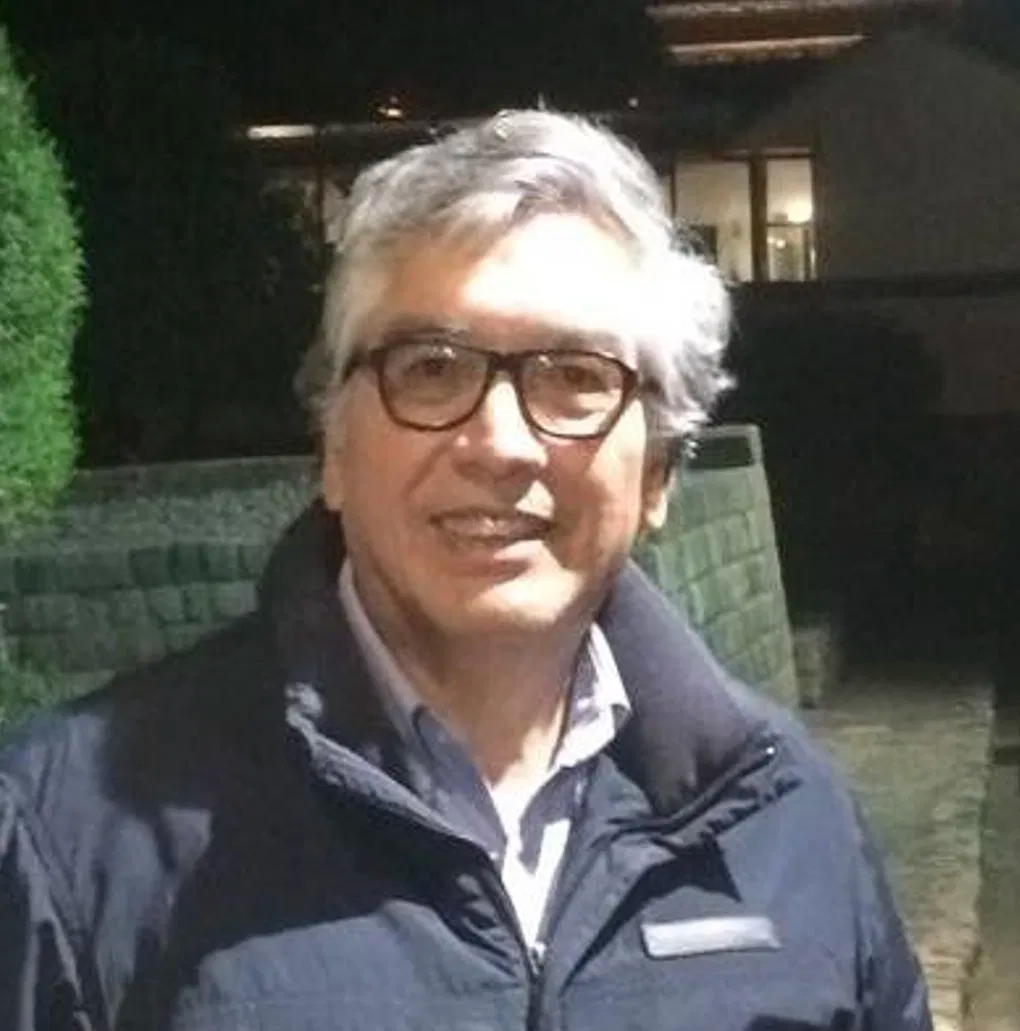
Après avoir soutenu une thèse sur « population et territoires du Pérou entre 1876 et 2005 » à l’Université Paris 5, Vidal Pino Zambrano a pu, comme Maire de Cusco, l’ancienne Capitale Inca, mettre en pratique ses années de recherche multidisciplinaire relatives à l’occupation et au développement du territoire, à l’utilisation des ressources naturelles, à l’organisation de la production, ainsi qu’aux infrastructures agro-pastorales et plus largement à l’économie et à la culture Inca. Professeur d’Université, docteur en ethnologie et sociologie, il a publié un ouvrage de référence sur les Incas : « Los Incas, Población y Producción entre la fantasia y la realidad ». Correspondant au Pérou, avec Helga Cecilia Frech Hurtado, Vidal Pino est membre du Comité de Pilotage de I-Dialogos.
=> ARTICULO EN ESPAÑOL et française
Pécheurs qui se croient rédempteurs : la crise politique au Pérou
Au cours des dix dernières années, le Pérou a connu huit présidents. Presque tous ont terminé leur mandat au milieu de crises politiques, de scandales de corruption ou de luttes de pouvoir. Chacun d’eux était arrivé au gouvernement en promettant un “nouveau départ”, se proclamant défenseur du bien, de la justice ou de la morale contre le mal des autres. Pourtant, dix ans plus tard, le pays reste prisonnier du même cercle d’instabilité, de méfiance et de détérioration institutionnelle. Cette répétition révèle quelque chose de plus profond que la simple incompétence : une dangereuse conviction morale qui traverse toute la classe politique.
À ce propos, l’écrivain russe Alexandre Soljenitsyne écrivait dans L’Archipel du Goulag que “l’idéologie donne au mal sa justification et au malfaiteur la détermination nécessaire”. Il n’y a pas de force plus dangereuse que celle de celui qui se croit vertueux. La politique péruvienne — et plus largement latino-américaine — fonctionne aujourd’hui selon cette même logique : le mythe de la supériorité morale, la croyance que les bonnes intentions suffisent à légitimer toute action, même les plus destructrices.
La gauche rédemptrice et la droite moralisatrice
La gauche péruvienne a fait de la morale son drapeau politique. Elle se présente comme la porte-parole des “pauvres” ou des “oubliés” et se considère détentrice du bien. Au nom de la justice sociale, on justifie des politiques improvisées, des discours de confrontation et des mesures populistes qui finissent par détruire ce qu’elles prétendaient protéger. Comme le rappelait Milton Friedman, l’un des grands erreurs de la modernité est de juger les politiques à leurs intentions plutôt qu’à leurs résultats.
Mais la droite n’échappe pas non plus au même piège. Elle invoque souvent la morale religieuse, l’ordre ou la défense des valeurs traditionnelles pour affirmer sa supériorité éthique. Elle se présente comme le rempart contre le chaos, tout en niant sa propre complicité avec la corruption, le clientélisme et l’inefficacité de l’État.
Ainsi, la gauche se victimise et la droite moralise, mais toutes deux reproduisent le même schéma : revendiquer la vertu tandis que le pays s’enfonce dans la méfiance et que la population survit grâce à l’auto-emploi.
La politique comme tribunal moral
Au Pérou, la politique est devenue un tribunal moral où chaque acteur se proclame juge de la vertu publique. Le Congrès légifère moins qu’il ne condamne ; les politiciens se présentent comme des sauveurs tout en négociant leur impunité ; et les médias prononcent des jugements moraux sans assumer la responsabilité de la polarisation qu’ils alimentent.
La gauche accuse la droite de défendre les privilèges ; la droite dénonce le populisme et la démagogie. Mais toutes deux utilisent la bannière morale comme bouclier d’impunité et comme arme d’attaque, dissimulant leurs intérêts et leurs erreurs derrière un discours de pureté. Malgré leurs différences idéologiques, elles partagent le même vice : la prétention à la supériorité morale.
L’économiste Thomas Sowell appelait cette attitude “la vision des oints” : une élite — politique, intellectuelle ou médiatique — qui se croit moralement supérieure et investie de la mission de refaçonner la société pour la sauver. Au Pérou, cette élite est faible, fragmentée et déconnectée. Les uns veulent “refonder la patrie” par le ressentiment, les autres “rétablir l’ordre” par la nostalgie. Tous revendiquent la pureté morale, mais aucun n’assume la responsabilité concrète de gouverner.
De l’utopie au cynisme
En une décennie et huit présidences, le Pérou est passé de l’utopie fervente au cynisme absolu. Le peuple élit un président pour gouverner, mais dans la pratique, le Congrès s’est arrogé ce rôle, devenant un second pouvoir exécutif de fait. Depuis dix ans, le Parlement détient le pouvoir politique réel à travers une succession de destitutions, d’alliances et d’absolutions qui répondent moins à l’intérêt national qu’à des pactes circonstanciels destinés à maintenir des parts de pouvoir et à assurer la survie politique.
Certains députés se présentent comme des rédempteurs révolutionnaires ; d’autres comme des restaurateurs de l’ordre moral. Mais tous commettent la même erreur : croire que le pouvoir les légitime moralement et que, par le seul fait d’occuper un siège, ils incarnent la vertu de l’État. En réalité, ils utilisent leur fonction pour s’approprier des espaces de l’appareil public, placer leurs proches et prolonger leur influence.
Le résultat est un pays sans cap politique, où l’éthique est devenue un bouclier rhétorique plutôt qu’une pratique publique. Pendant ce temps, l’économie survit non grâce à l’État, mais grâce à la capacité du peuple à s’adapter, inventer et résister. Ce sont les citoyens — et non les gouvernements — qui maintiennent le pays à flot, en ajustant leurs moyens, en diversifiant leurs activités et en créant des opportunités là où le pouvoir ne laisse que des vides.
Comme l’avait averti Friedrich Hayek, les tentatives d’imposer le bien d’en haut se terminent toujours par la coercition et l’échec, car personne ne possède la connaissance ni la vertu nécessaires pour planifier la vie des autres. Le Pérou a besoin de moins de prédicateurs et de plus d’administrateurs prudents. Non pas de héros moraux, mais d’institutions qui fonctionnent. Non pas de discours rédempteurs, mais de résultats mesurables. La lutte contre la pauvreté et la corruption doit être vertueuse, non par ses intentions, mais par son efficacité.
La responsabilité plutôt que la vertu
La véritable moralité politique ne se mesure pas aux intentions, mais aux conséquences. Elle ne naît pas de l’arrogance de se croire pur, mais de l’humilité de reconnaître ses limites. Quand les dirigeants — de tout bord — se croient les seuls représentants du bien, le dialogue meurt et la démocratie se dégrade.
Après huit présidents en dix ans, le Pérou n’a pas besoin d’un nouveau discours moral, mais d’une culture politique de responsabilité, de transparence et de vision d’avenir. Le défi n’est pas de trouver les “bons”, mais de construire des institutions solides qui limitent les “mauvais” et les empêchent de nuire.
La politique cessera d’être un champ de rédempteurs lorsque nous comprendrons que l’éthique ne consiste pas à proclamer le bien, mais à produire de bons résultats. Car, comme le rappelait Soljenitsyne, le mal ne commence pas lorsque quelqu’un agit avec méchanceté, mais lorsqu’il est convaincu d’agir pour le bien.
Vidal Pino Zambrano, Cusco, le 19 octobre 2025