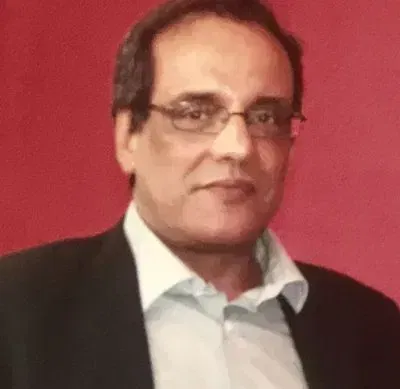
Abdoulahi ATTAYOUB est, à Lyon, le président de l’Organisation de la Diaspora Touarègue en Europe (ODTE) / Tanat. Il est aussi Consultant en relations internationales (Sahel) et membre du Réseau I-Dialogos.
 L’illusion d’un partenariat démocratique
L’illusion d’un partenariat démocratique
Contrairement à une idée répandue, la politique française au Sahel a souvent manqué d’exigence démocratique. En soutenant des régimes dont la légitimité électorale était, au mieux, contestable, elle a envoyé un message ambigu. À cela s’est ajoutée une tolérance excessive envers la corruption, y compris lorsque des fonds français ou européens étaient en jeu. Cette complaisance a profondément entaché l’image de la France auprès des démocrates africains, déçus de ne pas voir en elle un partenaire plus rigoureux et engagé.
En misant sur une stabilité de façade, la France a trop souvent soutenu des régimes en place sans considérer les réalités sociales, ethniques et culturelles propres à chaque pays. Elle a fermé les yeux, et ceux de la communauté internationale, sur des dérives manifestes, accordant de fait une forme de caution à des systèmes claniques et inadaptés.
Depuis le discours de La Baule, la France a toléré, voire couvert, des pratiques politiques relevant davantage de l’imposture démocratique que d’un réel engagement en faveur des peuples. Cette attitude a encouragé la captation des ressources publiques et un désintérêt croissant pour le bien-être des populations. Pire encore, elle a alimenté le désenchantement, ouvrant la voie à des régimes autoritaires, certes sans solutions durables, mais jouissant parfois d’un soutien populaire.
Une responsabilité partagée
Il serait toutefois injuste d’attribuer l’impasse actuelle à la seule France. Les pays sahéliens portent également leur part de responsabilité. Ils ne surmonteront la crise qu’en rompant avec les schémas politiques qui les ont fragilisés. Cela suppose la construction d’États de droit solides, dotés de véritables contre-pouvoirs, y compris dans la conduite de leur diplomatie.
Au-delà des discours populistes et opportunistes des juntes militaires actuellement au pouvoir, la critique adressée à la France demeure légitime. Pendant plus de soixante ans, elle a adopté une posture qui l’a rendue objectivement complice de dérives politiques majeures dans ses anciennes colonies. Pourtant, les liens historiques tissés avec les peuples sahéliens auraient pu permettre un accompagnement vertueux des jeunes États vers une souveraineté réelle, inclusive et moderne.
Repenser les relations pour l’avenir
Malgré ces errements, la France dispose encore d’atouts pour retisser un lien authentique avec les peuples du Sahel. À condition de tirer les leçons du passé et de proposer de véritables partenariats fondés sur les réalités locales et les aspirations populaires.
Pour instaurer une relation apaisée et bâtir des partenariats équilibrés, la France devra profondément réviser son approche. Elle devra privilégier des coopérations concrètes, équitables et centrées sur le développement. Les liens historiques doivent être revalorisés, non comme un vestige d’un passé postcolonial, mais comme un levier pour construire un avenir commun, respectueux de la souveraineté des peuples.
Le paysage géopolitique évolue rapidement. L’offre de partenariats s’élargit. Des acteurs européens, asiatiques ou émergents occupent désormais un espace que la France semble avoir déserté. Si elle ne prend pas conscience de ces mutations, elle risque d’être durablement marginalisée dans l’espace sahélo-saharien.
La rupture spectaculaire des relations avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso ne peut être réduite à de simples manœuvres de régimes militaires en quête de légitimité. Elle traduit un échec structurel : celui d’un modèle relationnel dépassé, incapable de répondre aux attentes des peuples. Le désenchantement envers la France doit aussi se comprendre à l’aune des espoirs qu’elle avait elle-même suscités, à travers des discours officiels promettant coopération et partenariats au service des populations.
Abdoulahi ATTAYOUB, le 8 septembre 2025