
Nathalie Delapalme est la directrice générale de la Fondation Mo Ibrahim, qu'elle a rejointe en 2010. Elle a précédemment occupé le poste d'inspectrice générale des finances au ministère français de l'Économie et des Finances (2007-2010). Auparavant, Nathalie Delapalme a été conseillère auprès du gouvernement français pour l'Afrique et le développement, au sein des cabinets de différents ministres des Affaires étrangères, entre 1995 et 1997 et entre 2002 et 2007. Elle a également été conseillère auprès du Sénat français, au sein de la Commission des finances et du budget, où elle a évalué les politiques fiscales et publiques entre 1984 et 1995 et entre 1997 et 2002. Elle est co-secrétaire générale de la Fondation Afrique-Europe et siège au conseil d'administration de l'International Crisis Group, au conseil consultatif de l'IFRI (Institut français des relations internationales) et au conseil scientifique de l'IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale). Elle est membre du Conseil européen des relations étrangères (ECFR) et du réseau d'experts du Forum économique mondial.
Nathalie Delapalme is the CEO of the Mo Ibrahim Foundation, which she joined in 2010.She was previously Inspecteur General des Finances at the French Ministry of Economy and Finance (2007-2010). Prior to this, Nathalie served the French Government as an advisor for Africa and for Development in the offices of various Foreign Affairs Ministers, between 1995-1997 and 2002-2007. She also served the French Senate as advisor for the Finance and Budgetary Commission, where she assessed fiscal and public policies between 1984-1995 and 1997-2002.She is co-Secretary General of the Africa-Europe Foundation and sits on the Board of International Crisis Group and on the Advisory Board of IFRI (Institut Francais des Relations Internationales) and on the Council Scientifique of the IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Defence Nationale). She is a member of the European Council on Foreign Relations (ECFR) and a member of the WEF’s Expert Network.
Propos recueillis par Pierrick Hamon et Jean-Claude Mairal
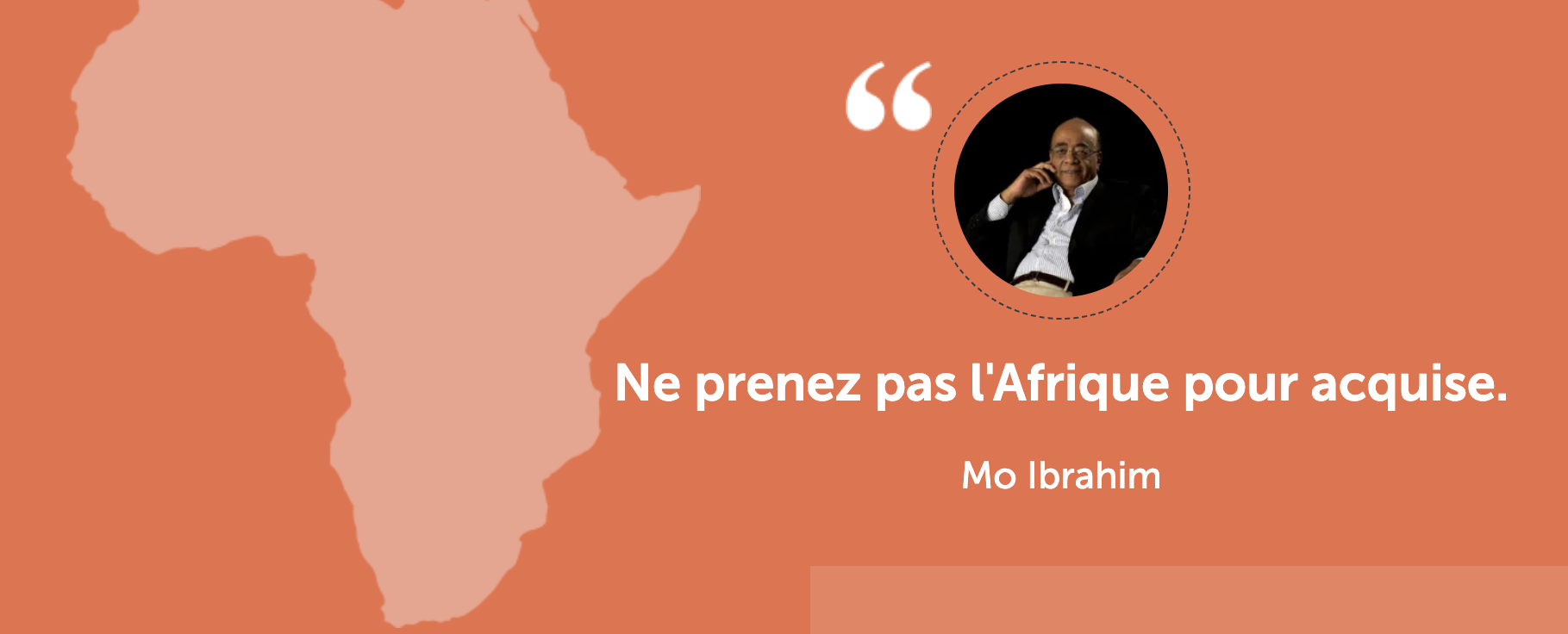
in English below
I-Dialogos : Nathalie Delapalme, I-Dialogos a choisi de centrer ses travaux sur la question de l’écoute et du dialogue comme condition de compréhension et de légitimité.
Nathalie DELAPALME : Le dialogue est incontestablement un outil essentiel pour progresser dans un environnement de plus en plus chahuté et incertain. Mais à condition de ne pas se résumer à l’échange convenu de simples « éléments de langage ».
Le véritable dialogue implique une discussion, à partir de points de vue qui peuvent être radicalement différents, voire divergents. A vrai dire, plus les divergences initiales seront importantes, plus le dialogue sera productif, et susceptible d’aboutir à des résultats. Il faut accepter au départ l’incertitude du résultat final.
Il est également important de ne pas se limiter à un échange entre « homologues », mais aussi d’élargir le dialogue a d’autres interlocuteurs. Par exemple, sur des sujets institutionnels, a la société civile, aux collectivités locales. Enfin, il ne suffit pas d’écouter, il faut aussi entendre, et accepter…
Ne pas confondre le principe avec le système
I-Dialogos : A propos de la Démocratie, ne conviendrait-il pas de mieux distinguer valeur et système ?
Nathalie DELAPALME : Tout à fait. Sur la démocratie, mais c’est vrai aussi du multilatéralisme, tous deux aujourd’hui assez bousculés, il est essentiel de ne pas confondre le principe avec le système qui le met en œuvre.
Pour défendre -je préfère promouvoir- le principe, il faut accepter de revoir le système, car ne défendre que le système risque bien de ne conduire qu’à la mort du principe.
Aujourd’hui, sur le continent africain par exemple, la démocratie ne peut pas être réductible à la seule tenue, à échéances plus ou moins longues, d’élections présidentielles, validées par des observateurs extérieurs.
La démocratie est aussi locale et participative, à l’image de l’ « arbre à palabres », espace de délibération collective finalement pas si éloigné de l’agora grecque fondatrice…Il faut aussi considérer l’impact des réseaux sociaux, et pourquoi pas de l’IA…
Pour défendre et promouvoir la démocratie, il parait donc essentiel de revenir, au préalable, sur la définition même de son principe, de ses valeurs, d’ouvrir un débat qui permette d’aboutir à une définition partagée, pour ensuite seulement définir le système le plus adéquat, au vu des évolutions démographiques, sociologiques, technologiques, qui permette d’assurer sa pérennité.
Ceci vaut au niveau national comme au niveau global : peut-on considérer aujourd’hui que le système multilatéral actuel – ONU, Bretton Woods est « démocratique » ?
I-Dialogos : Francophonie et/ou pluralité linguistique ?
Nathalie DELAPALME : Le dialogue implique le plurilinguisme. Un dialogue véritable n’existe que lorsqu’il accepte la diversité des langues et des cadres de pensée. Un dialogue monolingue n’est pas un vrai dialogue : celui qui impose sa langue impose aussi son cadre de pensée. Et puis surtout, il s’affaiblit : ne connaissant pas la langue de l’autre, il s’exclut des conversations en langue « étrangère » à la sienne, et perd de l’information.
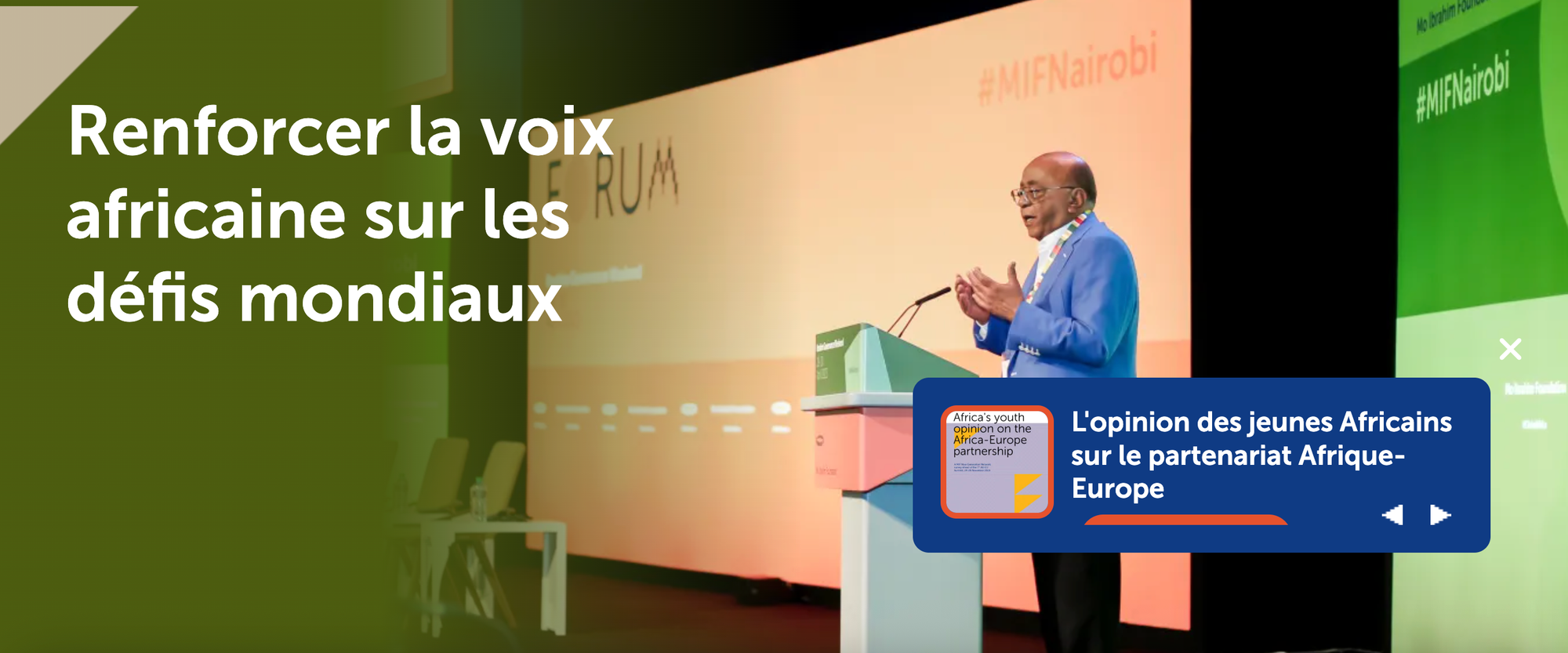
I-Dialogos : Vous dites qu’il faut "Re inventer l’Aide au Développement ». Le concept d’Aide est en effet de plus en plus mal perçu en Afrique et pas seulement. N’est il pas urgent de repenser nos manières de coopérer ?
Nathalie DELAPALME : La fermeture pour le moins brutale de l’agence d’aide américaine USAID a provoqué un choc, notamment en raison de son impact massif sur les secteurs de la santé et de l’appui aux sociétés civiles. Mais il faut mesurer qu’elle s’inscrit dans une tendance longue de diminution de l’aide chez les bailleurs historiques – la sécurité prend le pas sur la solidarité. Entre 2014 et 2023, la part de l’Afrique dans l’APD globale a perdu 11 points de pourcentage.
Dépasser la relation « donneur/récipiendaire »
Sur exactement la même période, les dépenses militaires globales ont progressé de 37%. S’y ajoute la volonté, du côté des « bénéficiaires », de dépasser définitivement cette relation « donneur/récipiendaire », perçue comme inégale et condescendante, au bénéfice d’un véritable partenariat, fondé davantage sur la notion d’intérêts mutuels que sur celles d’histoire partagée, de devoir moral, ou de valeurs communes, et qui assure souveraineté et autonomie de décision.
Les « nouveaux partenaires » qui se bousculent aujourd’hui sur le continent africain l’ont bien compris, qui détournent à foison cette rhétorique à leur propre avantage.
Fin inéluctable de l’aide au développement ?
De fait, la fin inéluctable de l’aide au développement telle que nous l'avons connue souligne aussi l’intérêt de mettre en œuvre de façon adéquate, le potentiel considérable des ressources domestiques africaines : actifs verts, fonds souverains, fonds de pension, fiscalité domestique...
Cette « crise » de l’aide est donc sans doute l’occasion ou jamais de changer de narratif, de changer de logiciel, et de changer de métrique : moins d’engagements purement financiers, plus de partenariats concrets en matière d’expertise, d’information, de couverture du risque.
I-Dialogos : Dans un monde de plus en plus interdépendant, où les frontières s’effacent sous le poids des défis communs, quelle place accorder aux questions du changement climatique, de la raréfaction de l’eau, de l’insécurité alimentaire ?
Nathalie DELAPALME : Le climat est un sujet qui appelle le dialogue par excellence. Parler de transition énergétique pour un continent où la moitié de la population n’a pas toujours accès à l’énergie n’a évidemment pas le même sens que dans les pays déjà développés dont tous les citoyens ont depuis longtemps accès à l’électricité et à ses bénéfices immédiats : éducation, santé, sécurité, emplois….
En outre, sur le sujet climat, l’Afrique ne peut être seulement perçue comme un continent particulièrement et irrémédiablement vulnérable, qu’il conviendrait comme toujours d’ « aider à s’en sortir », mais comme un acteur essentiel pour la mise en place d’une économie globale verte, compte tenu de ses actifs conséquents : sources considérables d’énergies renouvelables, patrimoine majeur en termes de biodiversité, réservoir de minerais critiques, capacité de séquestration carbone.
La question de l’eau est tout aussi cruciale : elle est à la base de tous les enjeux de climat et développement : sécurité alimentaire, santé, etc… Elle constitue également une source majeure de conflits, existants et potentiels.

I-Dialogos : Vous êtes à la tête de la Fondation Mo Ibrahim. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette Fondation ? Quels types de projets pouvez-vous financer ?
Nathalie DELAPALME : La Fondation Mo Ibrahim ne finance pas de projets, mais met à libre disposition des données et des analyses sur la gouvernance en Afrique, sur les grands enjeux du continent, et sur le point de vue spécifiquement africain sur les grands débats globaux : climat, pandémies, migrations, sécurité...
Ainsi l’Indice Ibrahim de Gouvernance africaine, publié tous les deux ans, couvre une centaine d’indicateurs fournis par une cinquantaine de sources officielles, qui permettent de mesurer, et de comparer dans l’espace et dans le temps, pour chacun des 54 pays du continent, la capacité des gouvernements à fournir à leurs citoyens, un panier commun de biens et services publics essentiels : éducation, emploi, infrastructures, justice.
Le rapport annuel du Forum Ibrahim consolide les chiffres et analyses existantes, et les principales conclusions des débats du Ibrahim Governance Weekend annuel, ce sur un sujet différent chaque année : financement du développement, migrations, urbanisation, jeunesse, agriculture, service public….
A ceux-ci s’ajoutent des notes ponctuelles plus ciblées : position africaine en amont des COPs, analyse et perspectives des coups d’état, lien entre conflits et ressources naturelles…., et, tout dernièrement, opinion de la jeunesse africaine sur le partenariat Afrique/Europe.
Tout ceci, et les données qui les sous-tendent, sont totalement libres d’accès.
Londres, le 22 novembre 2025
=> La Fondation
=> Réinventer l'Aide au Développement
=> Le rapport " Financing the Africa we want"
lire aussi => l'article de Serge-Mathias Tomondji
in english
To open a debate that leads to a shared definition of democracy.
I-Dialogos: Nathalie Delapalme, I-Dialogos has chosen to focus its work on listening and dialogue as a condition for understanding and legitimacy.
Nathalie DELAPALME: Dialogue is unquestionably an essential tool for making progress in an environment that is increasingly turbulent and uncertain. But only if it does not boil down to a conventional exchange of pre-packaged talking points.True dialogue implies a discussion grounded in points of view that may be radically different, even conflicting. In fact, the greater the initial divergences, the more productive the dialogue will be and the more likely it is to produce meaningful results. We must accept, from the outset, uncertainty regarding the outcome.It is also important not to limit ourselves to exchanges between “peers,” but to widen the discussion to other stakeholders. For example, on institutional issues, to civil society and to local authorities. Finally, it is not enough to listen; one must also hear, and accept…
Do not confuse principles with systems
I-Dialogos: When it comes to democracy, shouldn’t we better distinguish between values and systems?
Nathalie DELAPALME: Absolutely. Regarding democracy—but this also applies to multilateralism, both of which are now under strain—it is essential not to confuse the principle with the system that implements it.To defend—I prefer the word promote—the principle, we must be willing to revise the system, because defending only the system may very well lead to the death of the principle.Today, for instance on the African continent, democracy cannot be reduced to periodic presidential elections, observed and validated by external actors.Democracy is also local and participatory, in the spirit of the “palaver tree,” a space of collective deliberation that is not so far removed from the founding Greek agora. We also need to consider the impact of social media, and why not artificial intelligence…To protect and promote democracy, it seems essential to first revisit the definition of its principle and its values, and to open a debate that allows for a shared definition, before then defining the system best suited to ensure its sustainability in the face of demographic, sociological and technological evolutions.This applies at the national level as well as globally: can we consider today that the current multilateral system—UN, Bretton Woods—is “democratic”?
I-Dialogos: Francophonie and/or linguistic plurality?
Nathalie DELAPALME: Dialogue requires multilingualism. Genuine dialogue exists only when it embraces the diversity of languages and ways of thinking. A monolingual dialogue is not true dialogue: whoever imposes their language also imposes their intellectual framework. And above all, they weaken themselves: unable to understand the language of others, they exclude themselves from conversations held in a “foreign” language and lose access to information.
I-Dialogos: You argue that we must reinvent “development aid.” The concept of aid is increasingly misunderstood in Africa and beyond. Isn’t it urgent to rethink our approaches to cooperation?
Nathalie DELAPALME: The abrupt closure of the U.S. aid agency USAID has caused a shock, particularly because of its massive impact on the health sector and support for civil societies. But we need to recognize that this reflects a long-term trend: a decline in aid among traditional donors, where security is increasingly taking precedence over solidarity. Between 2014 and 2023, Africa’s share in global official development assistance declined by 11 percentage points.
Moving beyond the “donor/recipient” relationship
During exactly the same period, global military spending rose by 37%. At the same time, many “beneficiary” countries now wish to definitively move beyond the “donor/recipient” relationship, which is perceived as unequal and condescending, towards genuine partnerships based much more on mutual interests than on shared history, moral duty, or common values, and which ensure sovereignty and decision-making autonomy.The “new partners” now competing on the African continent have clearly understood this and exploit this rhetoric abundantly for their own benefit.
The inevitable end of development aid?I
In reality, the inevitable decline of development aid also highlights the opportunity to mobilize, more effectively, Africa’s considerable domestic resources: green assets, sovereign wealth funds, pension funds, domestic taxation.This “crisis” of aid is therefore perhaps the perfect moment to change the narrative, change the framework, and change the metrics: less purely financial commitments, more concrete partnerships in expertise, information, and risk coverage.
I-Dialogos: In an increasingly interdependent world, where borders are fading under the weight of shared challenges, what place should we give to issues such as climate change, water scarcity, and food insecurity?
Nathalie DELAPALME: Climate is, by essence, a subject that demands dialogue. Speaking of energy transition on a continent where half the population still lacks reliable access to electricity does not have the same meaning as in countries where citizens have long benefited from its advantages: education, health, security, jobs…Moreover, when discussing climate, Africa should not be viewed solely as a particularly and irreversibly vulnerable continent that we must once again “help overcome its challenges,” but as a key player in building a global green economy, given its massive assets: abundant renewable energy sources, exceptional biodiversity, critical minerals, and carbon sequestration capacity.The issue of water is equally crucial: it lies at the heart of all climate and development challenges—food security, health, and more. It is also a major source of existing and potential conflicts.
I-Dialogos: You lead the Mo Ibrahim Foundation. Could you tell us more about it? What kinds of projects does it fund?
Nathalie DELAPALME: The Mo Ibrahim Foundation does not fund projects. It provides open access to data and analysis on governance in Africa, on major continental challenges, and on specifically African perspectives on key global debates: climate, pandemics, migrations, security…The Ibrahim Index of African Governance, published every two years, covers around one hundred indicators from roughly fifty official sources, making it possible to measure and compare, across space and time, how effectively governments in each of the continent’s 54 countries deliver a common basket of essential public goods and services: education, employment, infrastructure, justice.The annual Ibrahim Forum Report consolidates existing data and analyses, as well as the main conclusions of the Ibrahim Governance Weekend annual debates, each year on a different theme: development financing, migration, urbanization, youth, agriculture, public service…These are supplemented by targeted briefs: Africa’s position ahead of COPs, analysis and outlook on coups d’état, links between conflict and natural resources… and most recently, the opinion of African youth on the Africa-Europe partnership.
All of this, and the data underlying it, is fully open and accessible to everyone.
London, November 22, 2025