
Née en Bretagne (France), Rozenn Milin a vécu dans une famille bretonnante. La langue bretonne fut donc sa première langue. Historienne de formation, elle est titulaire d’un doctorat en sociologie. L’essentiel de sa carrière professionnelle s’est déroulé, comme journaliste, dans les médias, à la radio, puis à la télévision (FR3). Elle a notamment été directrice générale de TVBreizh. De 2004 à 2006, elle est attachée audiovisuelle à l’ambassade de France à Pékin, chargée du cinéma, de la radio, de la télévision et des industries numériques. De retour en France à l'automne 2006, Rozenn élabore un projet de sauvegarde des langues en danger à travers le monde. En janvier 2008, le projet est repris par la Fondation Chirac et prend le nom de Sorosoro. Des équipes de tournage filment sur les 5 continents les langues et cultures menacées de disparition, en collaboration avec des chercheurs, linguistes et anthropologues. Elle réalise ensuite une série de programmes pour Arte sur les langues en danger en Afrique, une série intitulée "Ces langues qui ne veulent pas mourir". En 2022, elle soutient une thèse intitulée Du sabot au crâne de singe : histoire, modalités et conséquences de l'imposition d'une langue dominante : Bretagne, Sénégal et autres territoires. Rozenn Milin en a tiré un livre qui vient d’être publié aux éditions Champ Vallon : « La honte et le châtiment » qui fait quelque bruit dans « le Landerneau » poilitico-médiatique…
Comment une langue, la langue bretonne, autrefois florissante a-t-elle pu décliner aussi vite ? Quel a été le rôle de l’école qui sanctionnait les enfants qui commettaient la « faute » de s’exprimer dans leur propre langue et cela non seulement dans les différentes régions de France, mais aussi dans les anciennes colonies d’Afrique sub-saharienne? Interview.
Propos recueillis par Pierrick Hamon
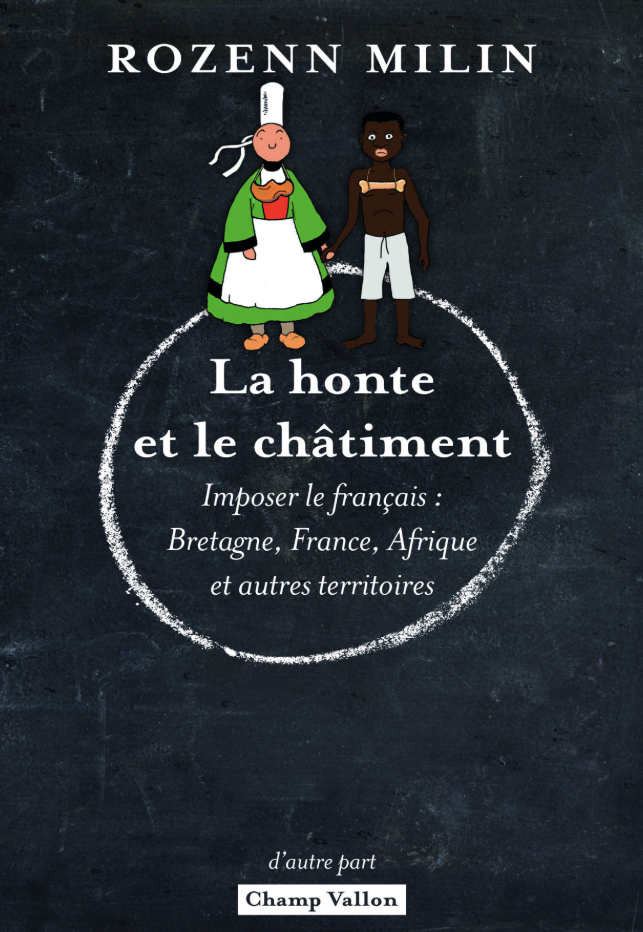
I-Dialogos : Rozenn Milin, vous venez de publier « La honte et le châtiment », un ouvrage dans lequel vous rappelez comment la République jacobine chargea les instituteurs, ces fameux « hussards noirs » – déjà tout un symbole – d’éradiquer brutalement ce qu’on appelle aujourd’hui les langues régionales. L’Abbé Grégoire voyait en effet la diffusion du français comme la seule manière d’unifier les provinces de France face à des langues régionales considérées comme des obstacles aux idéaux révolutionnaires. Pourtant les Girondins avec Mme Roland, plus décentralisateurs et attachés aux libertés locales, avant d’être envoyés à la guillotine, voulaient adopter une approche plus souple.
Rozenn Milin : Pour être plus précise encore, les révolutionnaires des premières années n’étaient pas du tout opposés aux diverses langues en usage sur le territoire français, et ils n’avaient aucune intention de les éradiquer. Pendant plusieurs années, ils ont au contraire opté pour la traduction des nouvelles idées, des lois et des décrets, dans les langues parlées par les différents peuples qui composaient la France.
C’est ainsi que j’ai par exemple retrouvé aux archives de Quimper la Déclaration Des droits de l’Homme et du Citoyen traduite en breton !
Mais quelques années plus tard survient la période de la Terreur (1793-1794), et tout change. Des personnages comme l’abbé Grégoire, ou le député Bertrand Barère, membre du Comité de Salut public, exhortent à mettre un terme à cette politique des traductions. Ils estiment en effet que les langues historiques parlées un peu partout en France seraient anti-révolutionnaires par essence ! Et ils décident qu’au lieu d’apporter aux peuples les idées nouvelles en les traduisant dans leurs langues, ils faut contraindre tous ces peuples à parler le français ! Ils vont même plus loin, puisqu’ils décident qu’il faut « anéantir », c’est le terme utilisé, tous les « patois et les idiomes ».
Ce n’est donc pas la Révolution qui est à blâmer, mais cette courte période de la Terreur, durant laquelle est élaboré le dogme de la langue unique, et rejetée toute idée de diversité. L’idéologie de l’époque voulait qu’aucune tête ne dépasse, et on sait à quel point ils étaient prompts à les couper…
Cette idéologie de la langue unique s’est ensuite installée dans les esprits, elle a traversé les siècles, et elle est malheureusement encore très présente aujourd’hui chez certains politiques.
I-Dialogos : Des pays comme l’Allemagne ou l’Italie n’ont-ils pas réussi leur unification tout en conservant une diversité linguistique qui ne les pas empêché d'affirmer une identité nationale forte ? N’est-ce pas ce jacobinisme, désormais d’abord « dans les têtes », qui est, de fait, à la source des difficultés actuelles de la société française, une société fondée sur un centralisme uniforme avec des citoyens qui attendent tout d’un État encore culturellement tellement centralisé ?
La France confond langue commune et langue unique
Rozenn Milin : Oui, l’un des problèmes de la France est qu’elle confond, en toutes choses, unité et unicité. Comme si on ne pouvait pas être unis en conservant une certaine diversité. Sur le plan linguistique, par exemple, la France confond langue commune et langue unique. Si l’on peut admettre qu’une langue commune est utile pour que tous les citoyens d’un même pays se comprennent, pourquoi limiter les pratiques à une langue unique ? Cela a fait des Français des monolingues, souvent handicapés pour apprendre d’autres langues !
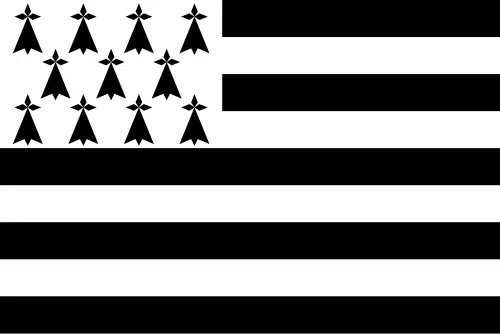
Il faut savoir aussi que sur ce plan la France fait figure d’exception : la majorité de la population mondiale parle en effet plusieurs langues, et en dehors de quelques autres pays gouvernés de manière autoritaire, cette idée de langue unique n’est pas comprise et elle est considérée comme totalement saugrenue.
A la différence de la France, la pluspart des pays ont plusieurs langues officielles
La plupart des autres pays européens autour de nous ont d’ailleurs plusieurs langues officielles, et cela ne les rend pas moins fonctionnels. Prenez la Suisse, par exemple : on y compte 4 langues officielles au plan fédéral, auxquelles s’ajoutent encore des langues officielles cantonales ! Est-ce que cela fait de la Suisse un État ingérable ? Assurément non. Et au contraire, la Suisse est probablement l’un des pays où la démocratie est pratiquée de la manière la plus directe, la plus évidente : dès qu’il y a une décision à prendre, ils mettent en place un référendum et tout le monde est consulté. C’est un État décentralisé et multilingue, parfaitement efficace.

https://www.sorosoro.org/le-programme-sorosoro/.
Et en Afrique aussi
Citons aussi l’Afrique. j’ai beaucoup voyagé en Afrique subsaharienne et j’ai été frappée de constater que la majorité des gens parlent, non pas deux langues, mais trois ou quatre : la langue familiale, voire les langues familiales en cas de mariage interethnique, une lingua franca africaine (le wolof, le pulaar, le bambara, etc.), et le français, parfois aussi l’anglais. Cela fait qu’ils sont parfaitement adaptables, capables de circuler un peu partout sans jamais être pris au dépourvu, et par ailleurs riches de cet accès à différentes cultures, à différentes formes de pensée. Le grand historien Ibrahima Thioub, ancien recteur de l’université Cheikh Anta Diop à Dakar, dit d’ailleurs que les pays africains ne seront jamais monolingues, le concept de la langue unique y étant totalement étranger car inopérant.

https://www.sorosoro.org/oceanie/.
Une langue KANAK
I-Dialogos : Alors que le nombre de personnes capables de parler breton est tombé à 107 000 selon une étude menée en 2024, comment voyez-vous l’avenir du breton ?
Rozenn Milin : Nous suivons depuis trois quarts de siècle une pente descendante très préoccupante. En 1950, il y avait encore un peu plus d’un million de locuteurs de breton. C’est-à-dire que la très grande majorité de la population, à la campagne, parlait breton tous les jours, et que la normalité était de parler breton. Mais les parents ont ensuite cessé de transmettre leur propre langue, et 75 ans plus tard, parler breton est devenu vraiment l’exception. Surtout, la plupart de ceux qui sont capables de le parler sont âgés de plus de 70 ans. On peut en déduire que les chiffres vont continuer de baisser drastiquement jusqu’à ce que tous les anciens soient décédés : d’ici 20 ou 30 ans il ne restera sans doute que 50 000 locuteurs, voire moins.
La perte de ces locuteurs traditionnels sera une perte immense, car avec eux disparaîtront des éléments culturels essentiels : la mémoire d’une histoire, un mode de pensée, une vision du monde, etc.

https://www.sorosoro.org/afrique/
Il reste à espérer qu’ensuite, une fois qu’on aura touché ce seuil, le nombre de brittophones pourra remonter avec ceux qui l’auront appris à l’école.
I-Dialogos : L’avenir ne passe-t-il pas en priorité par une vraie régionalisation de l’Éducation Nationale avec de vraies stratégies linguistiques, culturelles et d’éducation, dans le cadre français et européen ? Et cela à l’exemple, entre autres, des Flamands, des Irlandais, des Israéliens qui ont réussi à réveiller et développer leurs langues ? N’est-ce pas aussi le rôle de l’UNESCO ?
Rozenn Milin : L’école a été l’outil de la destruction des langues régionales en France, et c’est aussi par l’école que ces langues pourront être revitalisées. Mais il faudra un plan très volontariste, où tous les enfants pourront avoir accès à un enseignement dans la langue historique de leur territoire.
Les progrès de ce côté-là sont formidables au pays basque, par exemple, où la majorité des élèves de maternelle fréquentent désormais des écoles immersives en basque. En Catalogne, le gouvernement catalan du Sud contribue au financement de l’enseignement immersif du catalan côté français ! En Bretagne, en revanche, la situation est très mauvaise : à peine 3 % des élèves ont accès à un enseignement partiellement en breton !! Et il n’y a pas de véritable volonté politique de développer cet enseignement, ni à Paris, ni en région, à cause, précisément, de cette fâcheuse tendance au centralisme et à la négation de la diversité par les autorités françaises.

https://www.sorosoro.org/asie/
En Bretagne, les élèves des écoles Diwan ont des résultats supérieurs à la moyenne en France
C'est d'autant plus dommage que les résultats des écoles bilingues par immersion sont excellents. Par exemple, les élèves des écoles Diwan, en Bretagne, ont des résultats supérieurs à la moyenne en France, même en… français ! Et en effet, on connait bien aujourd’hui les avantages du bilinguisme précoce, qui est en particulier bénéfique sur le plan cognitif, et permet d’apprendre plus facilement d’autres langues. Des études en cours depuis une vingtaine d’années montrent par ailleurs que la pratique de plusieurs langues retarde l’arrivée de maladies neuro-dégénératives comme Alzheimer !
Quant à l’UNESCO, elle considère toujours que ces questions sont du ressort des États. Et comme la France se montre en règle générale hostile à la diversité linguistique, l’UNESCO n’intervient malheureusement pas.
I-Dialogos : La révolution de l’intelligence artificielle est en train de permettre l’accès à toutes les langues. Serait-ce une menace de plus ou un potentiel atout pour la langue bretonne? Serait-il ainsi possible de diffuser cette interview aussi en langue bretonne ?
Rozenn Milin : L’intelligence artificielle est un outil prometteur qui, en effet, peut permettre, par exemple, des traductions immédiates d’une langue à l’autre. Mais il ne faut pas croire que l’IA permettra à toutes les langues de s’en sortir. Car pour élaborer tous ces outils, il faut des corpus de données très importants, c’est-à-dire des enregistrements, des textes quand il s’agit de langues écrites, etc. Ces corpus sont nécessaires pour mettre sur pied la reconnaissance vocale d’une langue, les traductions automatiques, etc. Mais collecter des centaines d’heures d’enregistrement, les décrypter, les encoder, tout cela coûte de l’argent. Et les financements iront d’abord aux langues les plus répandues, pas aux langues parlées par seulement quelques milliers de personnes.
Mais il est vrai qu’il est important de ne pas rater le coche sur ces nouvelles technologies, car les langues qui ne seront pas présentes dans tous les champs du numérique auront beaucoup plus de difficultés à survivre. Là le breton n’est pas si mal placé : des outils de traduction automatique existent désormais, la langue est présente dans Google translate, etc. Et des chercheurs travaillent à développer toutes sortes d’outils.
Quid du projet SOROSORO de la fondation Chirac ?
I-Dialogos : Vous avez initié et piloté le projet SOROSORO au sein de la fondation Chirac, un projet justement centré sur la documentation filmée des langues en danger en Afrique et ailleurs. Puis vous avez réalisé une série pour la chaîne de télévision ARTE, sur les langues en danger en Afrique. Vous avez ainsi découvert que des pratiques scolaires similaires étaient en usage dans les pays d’Afrique et en Bretagne. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Rozenn Milin : Oui, j’ai découvert lors de ces différents tournages que, partout en Afrique subsaharienne francophone, on avait eu recours à la méthode du « symbole », une méthode probablement importée de Bretagne au XIXe siècle, d’ailleurs ! Le premier enfant surpris à parler dans sa langue maternelle à l’école devait porter, généralement autour du cou mais parfois dans la poche ou dans la main, un objet sans valeur et souvent dégradant. Ensuite il devait épier, voire piéger, ses camarades pour en trouver un autre qui commettrait la même « erreur », et lui refiler ce « symbole » de la honte. L’objet circulait ainsi de l’un à l’autre et à la fin de la récréation, ou de la journée, le dernier était puni.
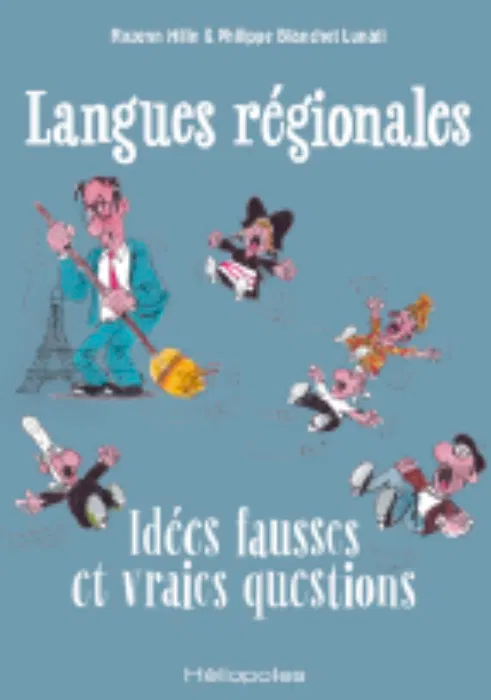
L'objet était souvent un sabot de bois en Bretagne, et un os d’animal en Afrique, par exemple un crâne de singe. Vous vous imaginez, à l’âge de 5, 6, 7 ou 8 ans, arpenter la cour de l’école ainsi affublé, voire rentrer chez vous paré d’un gros os autour du cou, sous les moqueries de vos camarades ? Quant aux punitions, elles consistaient en centaines de lignes à copier (« je dois parler le français », ou « je ne parlerai plus en breton, en sereer, etc. »), en retenues, en corvées de nettoyage ou en châtiments corporels, qui pouvaient être très violents, surtout en Afrique.
Cette pratique,basée sur la délation, l’humiliation et la sanction, s’est progressivement éteinte en Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, mais elle a duré bien plus longtemps en Afrique. Quand j’y ai fait mes recherches sur le terrain en 2017, j’ai été stupéfaite de découvrir que cette méthode d’un autre âge était toujours appliquée au Sénégal, dans certaines écoles confessionnelles et dans certaines écoles de brousse !
I-Dialogos : Notre ami Gabriel Cohn-Bendit avait créé le Réseau Éducation Pour Tous en Afrique (REPTA) et militait dans ce cadre pour l’enseignement des jeunes enfants, en Afrique et au Burkina Faso notamment, d’abord dans leur langue locale maternelle ? Qu’en pensez-vous ?
Rozenn Milin : Des initiatives de ce type existent dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, généralement mises en place par des ONG. Il parait en effet évident que l’on apprend plus facilement à lire et à écrire dans une langue qu’on maîtrise bien, comme la langue maternelle. Et à l’inverse il va de soi qu’apprendre la lecture et l’écriture dans une langue étrangère comme le français rajoute de la difficulté puisque les enfants ne comprennent pas ce qu’ils doivent lire et écrire.
Mais généraliser l’alphabétisation en langue maternelle prendra du temps, car il s’agit la plupart du temps de langues orales. Il faut donc que des linguistes fassent d’abord un gros travail de description de ces langues, qui peut prendre plusieurs années. Il faut ensuite décider d’une écriture et élaborer des dictionnaires, des grammaires, et toutes sortes de supports pédagogiques. Enfin, il faut former les enseignants qui, dans leur cursus, ont généralement appris à faire classe uniquement en français. Tout cela prend du temps et de l’argent, et donc une grande volonté politique.
Il y a aussi la question des parents qui, parfois, rechignent à voir leurs enfants recevoir un enseignement en langue maternelle car le français reste une langue prestigieuse qui ouvre toutes les portes. J’ai vu cela en particulier au Sénégal, où l’unique langue officielle est encore le français, et où cette langue est nécessaire pour obtenir un bon travail, pour s’élever dans l’échelle sociale. Mais les choses semblent progresser, au fur et à mesure que les programmes se mettent en place et qu’ils font leurs preuves. Dans certains pays, on a évalué qu’apprendre à lire et à écrire en langue maternelle faisait gagner une année d’école aux enfants. Ce n’est pas rien !
Publié en version numérique le livre est aussi accessible en Afrique, où je pourrais aussi venir le présenter
I-Dialogos : Votre livre sera-t-il diffusé en Afrique et ailleurs où on lit de plus en plus sur liseuses et autres. Au Sénégal au moins. Il y serait certainement très apprécié.
Rozenn Milin : Oui, le livre est bien sûr accessible en version numérique. N’importe qui peut l’acheter sous forme d’un e-book sur toutes les plateformes (FNAC, Amazon, etc.). Je donne par ailleurs beaucoup de conférences en France, qui suscitent toujours un grand intérêt car elles réveillent beaucoup de souvenirs enfouis et confusément douloureux.
Plusieurs amis ou collègues africains m’ont dit qu’ils aimeraient que je vienne présenter le livre chez eux également. Je pense qu’il est effectivement important que le grand public, y compris en Afrique, puisse prendre connaissance de ces mécanismes et comprendre comment se met en place le déclin d’une langue, et pourquoi il est important de sauvegarder la diversité linguistique. Alors si je suis disponible je ne dis jamais non à une invitation ! A bon entendeur…