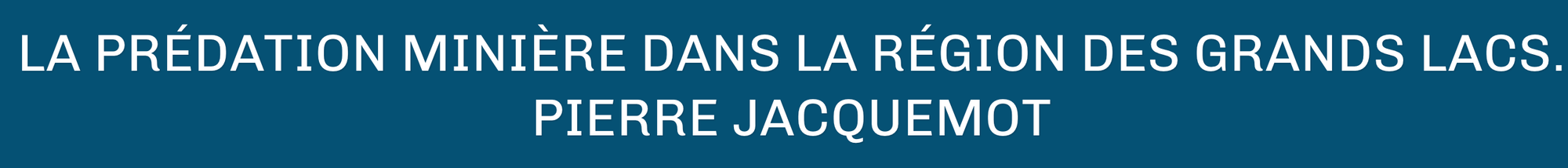Pierre Jacquemot est expert associé à la Fondation Jean-Jaurès. Diplomate et universitaire, ancien ambassadeur de France, ancien directeur de la coopération et du développement au ministère des Affaires étrangères, il est actuellement conférencier à Sciences Po Paris et président d’honneur du Groupe Initiatives. Membre du comité directeur du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), il est également membre du comité de rédaction de la revue Afrique contemporaine, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer. Il a dernièrement fait paraître Le dictionnaire encyclopédique du développement durable (Éditions Sciences humaines, 2021) ; Afrique. La démocratie à l’épreuve (Fondation Jean-Jaurès/L’Aube,2022), Se nourrir, le défi de l’Afrique (Karthala, 2024).
Propos recueillis par Pierrick Hamon, Jean-Claude Mairal et Tina Mwangelu.
Passer d’une logique d’assistance asymétrique à une logique d’enjeux partagés
I-Dialogos : Vous publiez un Rapport critique sur la coopération française au développement et évoquez l’« effondrement » d’un modèle. Pourtant, cela fait des décennies que le principe même de l’aide est contesté… Pourquoi considérez-vous qu’il est désormais donc nécessaire de passer de cette logique d’aide à une véritable relation de partenariat ? Qu’est-ce qui rend votre diagnostic aujourd’hui différent ou urgent ?
Pierre Jacquemot : Mon constat sur la déliquescence de l’aide publique au développement est aujourd’hui largement partagé. Pour ma part j’écris sur le sujet depuis des années pour dénoncer le caractère asymétrique de la relation introduite par ce dispositif mis en place après la seconde guerre mondiale et que, j’avoue, nous avons servi avec enthousiasme, mais probablement avec une pointe de paternalisme coupable.
Cela étant dit, la rupture est loin d’être faite avec cette catégorie obsolète qu’est l’APD. On s’étonnera de voir que le dernier rapport discuté à l’Assemblée nationale française, en octobre dernier, celui de Guillaume Bigot, député du Rassemblement national, s’intitule « Aide publique au développement ».
Pourtant, on assiste aujourd’hui à une brutale perte des moyens budgétaires du rayonnement français et de l’influence de notre pays. La chute sera proche de 40% sur trois ans. Depuis 2024, les trois premières victimes des coups de rabot budgétaires sont les ONG (dont 64 d’entre elles perdent brutalement 10 000 emplois dès maintenant, soit un effectif identique à celui du réseau diplomatique français dans le monde), la recherche africaniste française et tout le réseau culturel et les établissements scolaires. Des projets sont fermés. Beaucoup d’associations sont menacées et sont dans le « sauve-qui-peut ».
Ce qui m’attriste le plus c’est que faute de moyens, l’intégration des jeunes Français dans la solidarité internationale, via les ONG notamment, est bloquée. On assistera à une rupture générationnelle dans le secteur. Dans ces conditions, chacun s’accorde aujourd’hui à l’affirmer : une totale refondation est désormais indispensable. Elle impose de passer d’une logique d’assistance asymétrique à une logique d’enjeux partagés.

https://www.fraterniteafrique.fr.
Regagner l’estime des Africains passe par des actions qui mettent en avant la solidarité, plutôt que l’injonction éthique condescendante ou la réprimande indignée. La logique d’action pourrait devenir celle de l’échange de pratiques, de l’écoconstruction, du lien territoire à territoire, de la capitalisation commune, de la montée en échelle et des garanties de transparence et de redevabilité.
I-Dialogos : Quid en ce sens de l’avenir de la Francophonie et de l’OIF alors que le plus grand pays francophone n’est pas la France, mais le Congo RDC… en Afrique ?
Pierre Jacquemot : Les institutions de la francophonie sont muettes sur ce sujet, comme sur d’autres sujets d’ailleurs. J’ai été en poste pendant 25 ans à l’étranger et je n’ai quasiment jamais rencontré, et encore moins travaillé, avec des représentants de l’OIF.
Savez-vous que la formule qui déclare que la RD Congo est le premier pays francophone du monde date de la venue de Nicolas Sarkozy à Kinshasa en mars 2009. Une formule que j’avais inventée pour la circonstance, mais qui a un sens très relatif lorsque l’on sait que le pays parle plutôt le lingala, le swahili, le tshiluba ou le kikongo, même si le français est la langue officielle, utilisée dans l’éducation et l’administration. Combien compte-t-il de vrais locuteurs francophones ?
I-Dialogos : Quid de toutes ces agences — notamment l’AFD — et des dispositifs technocratiques du Nord qui décident à la place des pays partenaires, sans vrai contrôle ni stratégie politique ? Est-ce le symptôme d’une politique publique sans vision de long terme et d’une coopération qui reste pilotée par les bailleurs plus que par les bénéficiaires ?
Pierre Jacquemot : Le procès qui est fait en France à l’Agence française de développement est largement injuste, faux et absurde. Il relève d’une analyse sommaire, non conforté par des observations de terrain. Selon ses détracteurs, l’AFD ne servirait pas les intérêts nationaux, contribuant à un « gaspillage des ressources publiques ».
La rhétorique de « la Corrèze plutôt que le Zambèze » est remise au goût du jour par des élus conservateurs et d’extrême droite pour la plupart, ne reculant pas devant les interprétations hasardeuses et les conclusions hâtives. Il faut se méfier de ce genre d’attaques qui cache mal des intérêts sournois. Les attaques sans fondement nuisent à la mobilisation au moment où il faut engager des réformes qu’imposent les nouvelles donnes géopolitiques. Sait-on que la coopération est l’une de politiques publiques les plus évaluées et qui, sans cesse, doit se mettre en question au regard des résultats obtenus ?
L’AFD a des stratégies confortées par le dialogue avec les partenaires et si certains pensent qu’elle jouit d’une trop grande indépendance, c’est probablement parce que les tutelles et les politiques n’exercent pas pleinement leur rôle.
Cela étant dit, des progrès sont toujours possibles. Ils s’imposent pour répondre à la baisse drastique, unique par son ampleur dans l’histoire de la coopération française, des moyens qui lui sont accordés.

I-Dialogos : Face à ces dérives, vous valorisez les approches territoriales et une gouvernance plus ascendante — « bottom up » — impliquant davantage les sociétés civiles. Comment dépasser le système de l’« appel d’offres », qui entretient une relation donateur–bénéficiaire et déresponsabilise les acteurs locaux ?
Pierre Jacquemot : La réflexion sur la « localisation » de l’aide — terme impropre puisqu’il s’agit plutôt d’une « délocalisation » — est intense depuis 5-6 ans dans divers milieux, associatifs et universitaire surtout, en France, mais aussi en Europe. Il débouche sur plusieurs principes :
adopter le principe selon lequel on ne peut contraindre une société à suivre un projet d’avenir qui n’est pas le sien ;
chercher à créer les conditions favorables pour « passer la main », en jouant, dans un dialogue décomplexé, sur les capacités autonomes du bénéficiaire ;
accompagner les acteurs du changement, en tenant compte de l’arrivée d’une nouvelle génération, ouverte sur le monde, ayant pris ses distances avec les élites post-indépendance ;
s’appuyer sur de nouveaux acteurs du changement, les universitaires, les responsables d’ONG, les journalistes, les artistes…
Les perspectives sont prometteuses et passionnantes.
Faire une place plus importante contributions de la société civile
I-Dialogos : Vous appelez à une « révolution culturelle », notamment du côté des institutions du Nord. Cela implique-t-il de repenser la coopération décentralisée et l’action internationale des collectivités, désormais confondues au ministère avec l’appui aux ONG ?
Pierre Jacquemot : Je rentre de Chine et j’ai appris ce que fut la « Révolution culturelle ». Je n’emploierai donc pas cette expression. Mais je vous réponds en vous disant que l’action des collectivités locales comme celles des ONG sont souvent exemplaires par leur proximité avec le terrain, ce qui les distingue de la coopération étatique.
Sait-on que 80 % au moins des acteurs des ONG françaises sont des actrices et acteurs des pays concernés ? Là aussi, il y a un procès fondé sur des a priori loin des réalités qui voit dans les ONG des bandes de baroudeurs incontrôlables, de boy-scouts dispendieux, qui jouent avec les deniers publics.
Nous avions la même critique pénible envers les coopérants des années 1960-1990 qui pourtant se distinguaient par, une « compétence affective » construite autour du culte du terrain, une mentalité de pionnier, une fidélité à l’Afrique, à l’Asie ou à Haïti, une certaine indocilité hiérarchique aussi, qui les distinguaient des fonctionnaires métropolitains.
Le rétrécissement de l’espace civique en Europe, orchestré par des gouvernements populistes et autoritaires, s’attaque aux bases de la solidarité́ internationale.
Mais il reste une forte adhésion des Français à la coopération internationale, et il pense d’abord à l’Afrique. Selon les enquêtes d’opinion, deux tiers des Français estiment que la France et l’Union européenne devraient investir davantage dans l’aide internationale, perçue comme une obligation morale et un investissement à long terme dans l’intérêt de la France.
Les priorités des citoyens incluent la contribution à la stabilité́ et à la paix dans le monde et la lutte contre le dérèglement climatique. Les questions migratoires et l’impact économique direct sur la France sont vécus comme moins prioritaires. Les ONG sont perçues comme plus efficaces que l’État français et ses agences pour la mise en œuvre de la solidarité internationale. Ce qui souligne la nécessité́ pour l’État de faire une place plus importante aux contributions et propositions de la société civile.
I-Dialogos : Vous invitez à mieux prendre en compte les travaux d’organisations comme la Fondation Mo Ibrahim, qui montre que l’Afrique attire très peu d’investissements malgré des rendements élevés. Que révèle, selon vous, ce paradoxe sur les choix des bailleurs ? cf interview I-Dialogos et l’article APD de Nathalie Delapalme qui rejoint votre propos.
Pierre Jacquemot : J’ai beaucoup de respect pour Nathalie Delapalme et pour les travaux de la Fondation Mo Ibrahim. Comme d’autres institutions de recherche et de plaidoyer, elle observe que les ressorts profonds des profondes transformations en cours derrière les évènements récents sur le continent sont multiples : contestation des formats politico-institutionnels hérités des années 1990, dissociation sociale associée à l’urbanisation, ébranlement de l’autorité familiale, aggravation des conflits générationnels, rébellion silencieuse des femmes, montée des inégalités, ébranlements de la gouvernance sur l’effet des trafics en tout genre (drogues, êtres humains, etc.)…
Pour comprendre ces transformations et les luttes multiformes qu’elles entraînent et leur inscription dans la longue durée, il faut radicalement changer d’optique, abandonner les vieilles grilles d’analyse, écouter les dynamiques endogènes et partir de nouveaux postulats.
Nous ne pouvons qu’être d’accord avec Mo Ibrahim et les intellectuels africains. L’intelligence collective dans les Afriques se situe là, dans les organisations transcommunautaires de la société civile, les mouvances citoyennes digitalisées, les laboratoires d’idées, les groupements de femmes, de jeunes, de producteurs…
Chez celles et ceux qui témoignent, retransmettent, interpellent, qui proposent des contre-mesures pour une « démocratie radicale » à la portée des citoyens afin de limiter l’absolutisme des dirigeants, les « en haut-d’en haut ».
I-Dialogos : Pour ce qui concerne les investissements, je relève effectivement ce paradoxe apparent entre les rendements potentiellement élevés et la réticence des investisseurs étrangers à s’y engager. La réponse est connue : le risque est plus élevé qu’ailleurs.
Pierre Jacquemot : Les investisseurs financiers considèrent que les rendements ajustés au risque des projets en Afrique sont moins attrayants qu’ailleurs dans le monde, en particulier au cours de la dernière décennie. Cette situation serait due à deux facteurs :
1/les défaillances du marché́ spécifiques à l’Afrique qui limitent les rendements privés ;
2/ les risques d’investissement élevés qui se cristallisent plus autour d’une préparation déficiente des projets, d’un risque de change élevé́ et de difficultés de rapatriement des profits Mais les solutions sont également connues.
Des garanties peuvent être accordées par les bailleurs publics aux opérateurs privés pour couvrir les risques commerciaux ou non commerciaux (expropriation, restriction et inconvertibilité́ des transferts de devises, guerre et troubles civils, etc.).
Les bailleurs peuvent réaliser des investissements en capitaux propres « patients » dans des projets rencontrant de hautes menaces. Certaines expériences conduites depuis de nombreuses années par des entreprises françaises peuvent être considérées comme significatives d’une prise en considération de la dimension sociale et écologique de leurs activités.
L’adoption de chartes et de codes de bonnes conduites traduit un mouvement de fond, peut-être même — à en croire certains analystes — une mutation du modèle économique dominant. Compliance, devoir de vigilance, Responsabilité sociétale et environnementale, ESG…, le cadre juridique est devenu très contraignant.
La coopération au développement doit être repensée
I-Dialogos : La fragmentation actuelle de l’action internationale — entre ministères, agences, collectivités, ONG souvent concurrentiels — ne nuit-elle pas à la cohérence et à l’efficacité de la coopération ? Faut-il sortir du cloisonnement et rechercher des synergies y compris sur le plan européen ?
Pierre Jacquemot : Sous l’effet des attaques dont elle est l’objet, il est clair que la coopération au développement doit être repensée, dans sa finalité comme dans ses méthodes. Doit être (enfin) évacué du vocabulaire le mot « « aide » qui est décidément encore difficile à évincer dans les milieux OSI.
Redonner une légitimité à la coopération internationale auprès de l’opinion publique.
En trouvant les bons mots : solidarité et intérêts réciproques bien compris. Ne plus parler d’aide, mais de partenariats solidaires, d’enjeux partagés, d’intérêts mutuels. Abandonner la verticalité, le regard condescendant qui prévaut encore. Introduire plus de flexibilité dans l’exécution, tolérer plus de risques, éviter de recourir à des schémas linéaires simplistes pour mesurer les résultats.
Les Consulats sont devenus des fabriques à ressentiments
I-Dialogos : Quel rôle stratégique pourraient jouer les diasporas africaines, souvent porteuses de compétences et de capitaux, mais dont l’action comporte aussi certaines ambiguïtés ?Beaucoup d’étudiants africains choisissent désormais d’étudier ailleurs, notamment à cause de la question des visas.
Pierre Jacquemot : Sans équivoque, les mobilités sont à la fois une ressource et un facteur de développement pour les territoires qui sont concernés, ici comme là-bas. Les migrants sont des acteurs à part entière du développement en y contribuant par leurs apports, intellectuels, financiers, techniques et culturels.
Le rôle des diasporas envers leur pays d’origine est bien connu. Les transferts de compétences au retour des migrants dans leur pays contribuent à l’amélioration de la qualification globale. Ces gains en capital humain et en capital social (densité du réseau, aptitude à coopérer) sont significatifs même s’ils sont moins perceptibles que le capital monétaire.
Les transferts d’argent des migrants vers leur pays d’origine constituent un autre apport significatif. Souvent les montants de ces transferts sont voisins de ceux alloués à l’aide au développement ou à l’investissement direct. Même en situation de crise économique et financière des pays de résidence des migrants, les flux d’argent tendent en plus à rester stables, du moins dans un premier temps.
Ils sont un facteur de réduction de la pauvreté et aident à préserver les habitudes de consommation des ménages. La consommation accroît la demande de produits locaux et elle peut, par un effet multiplicateur indirect, promouvoir l’emploi et l’investissement. Ils jouent souvent en faveur de la scolarisation des enfants ou de la prise en charge des dépenses de santé. Plusieurs pays cherchent à exploiter cette manne avec des « obligations de la diaspora » pour financer des projets sociaux (logements, écoles, hôpitaux).
Des études montrent que les fonds rapatriés sont de plus en plus investis, surtout pour financer des petites ou moyennes entreprises ou des petits projets d’infrastructure.
Les effectifs des étudiants africains en France sont encore très élevés
Pierre Jacquemot : ls sont 90000. Ils étaient 50 000 en 2025. Notre pays est un pays attractif. Le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun dominent le classement.
C’est l’occasion de dénoncer un mal qui envahit toute l’Europe. Chaque jour, dans les Consulats, en humiliant les demandeurs de visas, on détruit l’influence culturelle et politique et on construit des inimitiés durables. Les Consulats sont devenus des fabriques à ressentiments. Je parle avec mon expérience diplomate.
On prive les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs, les artistes et les élites de fréquenter la France et l’Europe et d’y nouer des rapports de travail et d’estime réciproques.
En Afrique, les jeunesses s’impatientent, souvent laissées sans horizon. Au fur et à mesure que les jeunes Africains, affamés d’avenir, cherchent une place, une voix, la France se replie sur ses peurs et ses frontières. Les légitimes désirs de mobilité rencontrent des murs et des refus.
Les Africains sont animés par leur vitalité, les Européens (et les Français en particulier) sont fascinés par leur longévité. Mais ni les uns ni les autres ne parviennent à formuler un projet commun.
I-Dialogos : Vous affirmez que la dénonciation de la « Françafrique » n’a plus de sens aujourd’hui. N’a-t-elle pas été remplacée par une sorte de « nouvelle franco-africaine » donneuse de leçons morales très françaises ?
Pierre Jacquemot : La « France-à-fric » a en effet largement laissé la place à d’autres modalités de la relation avec les pays africains, du moins là où les États africains ont voulu rompre avec cette méchante manière de faire.
Le secteur de la coopération est à un moment charnière, où sa survie dépend de sa capacité à se réinventer et à démontrer sa valeur ajoutée face à l’opinion publique et aux acteurs politiques.
Cette transformation est une opportunité́ de « co-construire d’autres façons d’habiter le monde » et de promouvoir l’apprentissage et l’entraide entre pairs. La solidarité́, étant donné sa nature, est nécessairement politique, et sa défense est essentielle pour un monde vivable en commun. Il est impératif de redonner une place centrale aux principes d’humanité́ et de solidarité́ dans les discours et les décisions politiques.
Le propos devient politique et engage le secteur sur le chemin moins maitrisé de la controverse, du rôle de contre-pouvoir plus assumé, afin de se tenir résolument du coté́ des plus faibles.
I-Dialogos : Au-delà de la critique, quel modèle de coopération proposez-vous, et comment appréciez-vous les avancées de la Loi Berville que vous mentionnez dans votre rapport ?
Pierre Jacquemot : La loi Berville de 2021, dont il n’est pas inutile de rappeler le nom (« loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales »), qui fut précédée d’une large concertation et qui fut adoptée à l’unanimité des deux chambres, demeure la meilleure référence. Hélas, elle a été détricotée depuis 2023 et aujourd’hui on estime qu’elle n’a été appliquée que pour un tiers des décisions qu’elle comprend. Ces professionnels mettent en pratique des démarches novatrices dans des domaines clés (nutrition, agroécologie, électrification rurale, filières courtes, droits fonciers, pépinières urbaines, gestion des déchets, microfinance…, la liste est longue), sur la base de capitalisations scientifiquement conduites. Le passage à l’échelle demeure toutefois le problème majeur.
Parlons plutôt des « laboratoires d’idées »
I-Dialogos : Quelle place pour les think tank (Fraternité Afrique, I-Dialogos,…) ?Nous évoquions la francophonie.
Pierre Jacquemot : Parlons plutôt des « laboratoires d’idées ». La situation critique dans laquelle nous sommes tous, loin d’être conjoncturelle, s’inscrit dans la durée et requiert des actrices et acteurs, praticiens et chercheurs, une adaptation profonde des modes d’action et des Stratégies, et beaucoup de courage.
La construction d’une réflexion politique est indispensable pour la refondation de la coopération (un bon mot : coopération), autour d’une nouvelle histoire, décolonisée, se racontant entre partenaires, impliquant une multitude d’acteurs (mouvements citoyens, groupements de jeunes, collectivités locales, ONG, entreprises de toute taille), sans donneurs de leçons, avec davantage d’échanges scientifiques et culturels diversifiés.
=> Le Rapport de Pierre JACQUEMOT : L'Afrique , un nouveau modèle de coopération au développement
Cf Repenser l’aide au développement (Jean-Claude MAIRAL)