
in Transform! italia
in italiano => Guerra e pace
in English below
Né à Naples, Mario BOFFO est un Diplomate italien auteur de plusieurs romans. IL a été ambassadeur notamment au Yemen et en Arabie Saoudite. Il collabore à plusieurs revues dont LAB Politiche e Culture, partenaire de I-Dialogos.
Les guerres ne se sont jamais terminées par des « paix justes », notamment parce qu’il ne s’agit pas d’un concept absolu, mais plutôt susceptible d’être perçu de manières relativement différentes par les parties adverses. En fin de compte, il s’agit d’un concept qui relève davantage de la propagande que du concret. A la fin d'une guerre, il y a toujours quelqu'un qui a gagné et quelqu'un qui a perdu, dans les diverses déclinaisons où l'on peut lire une victoire ou une défaite. Il n’y a qu’une seule paix juste : celle qui naît du traitement diplomatique des problèmes, de l’équilibre des pouvoirs, du partage de la sécurité, de la reconnaissance mutuelle, des garanties mutuelles, de la maîtrise de l’instrument militaire nécessaire, du développement du dialogue. Ces facteurs peuvent prévenir et éviter les guerres. Ou bien ils peuvent reconstruire la paix après une guerre. Tant que la défaite est reconnue, les massacres et les dévastations ne se perpétuent pas sans issue, des visions profondes sont élaborées sur les relations entre les pays et entre les puissances, et les problèmes et les questions qui ont déclenché la guerre sont ramenés sur la table des négociations. Tout cela implique de la douleur, des compromis, des négociations longues et parfois épuisantes ; il faut aussi accepter les impositions, car il n’est pas toujours possible de négocier sur un pied d’égalité. Dans ces termes, les nombreux échecs de l’Union européenne au cours des dernières décennies sont mis en évidence, depuis qu’elle a abandonné l’approche fondée sur le dialogue qui avait été ouverte à l’époque de Gorbatchev pour s’aligner sans esprit critique sur la logique de l’élargissement autoréférentiel de l’OTAN dirigée par les États-Unis vers les frontières de la Russie. Non pas la maison commune « de Vancouver à Vladivostok », espérée par le leader historique russe, en substance, mais la chute progressive et ruineuse d’Helsinki au Donbass.

L’Europe a manqué de nombreuses occasions de croissance, de cohésion et de développement d’un rôle international non marginal ; elle aurait pu tenter de résister (même si ce n’était pas facile) à la poussée vers l’élargissement de l’OTAN, en valorisant la logique et les outils de l’OSCE, qui découlent directement du processus d’Helsinki ; elle aurait pu promouvoir avec plus de force qu’on ne l’a tenté une identité spécifiquement européenne au sein de l’Alliance atlantique ; il aurait pu lancer des paroles et des programmes de paix et de cessation des combats à la veille ou au début de la guerre en Ukraine ; aurait pu, à tout moment au cours de ces trente longues années, remettre l’accent sur la nécessité de concevoir la sécurité européenne en termes collectifs. Certes, l’Europe n’avait pas et n’a pas la force militaire ni la cohésion politique pour imposer tout cela ; mais elle aurait au moins acquis une autorité capable de lui permettre un rôle d'interlocuteur, au fil des années et maintenant, à l'heure où se poursuivent les hypothèses de cessation de la guerre en Ukraine. Il aurait pu encore aujourd'hui, malgré tout, récupérer une partie du temps et des messages politiques qui ont pu être dispersés au cours des trente dernières années, afin de regagner un minimum de crédibilité. Au lieu de cela, il a produit les cinq points tardifs qui ont émergé du dernier sommet et l’accord pour une militarisation coûteuse, risquée et non planifiée.
La déclaration du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 6 mars, approuvée par vingt-six sans le consentement du Hongrois Viktor Orban, confirme les principes que les Européens reconnaissent pour parvenir à une « paix juste » en Ukraine : a) il ne peut y avoir de négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine ; (b) il ne peut y avoir de négociations affectant la sécurité européenne sans la participation de l’Europe ; (c) toute trêve ou tout cessez-le-feu ne peut avoir lieu que dans le cadre d’un processus conduisant à un accord de paix global ; d) tout accord de ce type doit être accompagné de garanties de sécurité solides et crédibles pour l’Ukraine, qui contribueront à dissuader toute future agression russe ; e) la paix doit respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Ces principes, qui auraient été dignes d'être pris en considération et susceptibles d'influencer le cours des choses au début immédiat du conflit, sont aujourd'hui complètement dépassés par les événements, étant donné l'intention américaine de terminer la guerre de toute façon, même en opérant avec une certaine brutalité, et risquent d'apparaître hors du temps et complètement en contraste avec ce qui, qu'on le veuille ou non, se passe. En fait, l’Europe n’a aujourd’hui ni la force ni l’autorité de les mettre sur la table des négociations avec un quelconque espoir. Kiev, et peut-être l’Europe, apparaîtront probablement dans le tableau final, mais seulement après que les décisions auront déjà été prises par les acteurs de soutien américains et russes. Les principes énoncés dans les cinq points, soutenus et plus largement modulés vers le milieu des années 90, ou fermement proclamés au début de la guerre, auraient peut-être pu avoir un certain succès. Aujourd’hui, malheureusement, ils sont confrontés à une réalité désagréable, à laquelle l’Europe a contribué par son indolence de plusieurs décennies et par les positions aveugles adoptées au début du conflit armé.
Le réarmement proposé par von der Leyen souffre de la même indolence qui dure depuis des décennies. La défense européenne commune est une question importante, à laquelle il aurait fallu réfléchir dès la fin de la Guerre froide, car il était clair dès lors que les orientations sécuritaires américaines allaient progressivement s'éloigner de l'Europe (les attitudes inciviles et vulgaires de Trump ne sont que l'accélération d'un processus commencé il y a quelque temps). La défense commune n’est cependant pas une simple question de savoir combien investir dans l’armement, mais plutôt de savoir comment collaborer entre les pays, les états-majors, les industries militaires ; quelles structures intergouvernementales ou communautaires mettre en place pour la gestion de la défense ; quel concept stratégique adopter ; de la manière de nous libérer des approvisionnements américains en développant une recherche solide et collective et une production européenne commune.
Mais surtout, il nous faut savoir et décider à quoi servira la défense européenne : une Europe unie et cohésive, ou un ensemble de pays diversement unis et souvent querelleurs ? Paradoxalement, les investissements prônés par Von der Leyen, qui seront exclusivement nationaux, n’auront d’autre résultat que d’accroître les achats d’armement américains et d’anéantir complètement l’espoir de maintenir un semblant d’État-providence sur notre continent. De plus, l'Europe, armée selon les décisions adoptées à Bruxelles, compte tenu des divisions existant entre ses membres et de l'absence, si ce n'est rhétoriquement proclamée, d'une vision commune, risque d'être encore plus faible, car il n'est pas certain - jusqu'à ce qu'un véritable projet unificateur et unitaire soit enfin élaboré - que les différents membres mettent réellement en commun leurs armes pour affronter ensemble les crises du futur. Alors autant dire les choses par leur nom : nous allons augmenter les budgets militaires et acheter davantage d’armes aux Américains dans l’espoir (pas encore garanti) qu’ils ne nous abandonneront pas complètement. Pas une belle vision. Pas un gros projet.
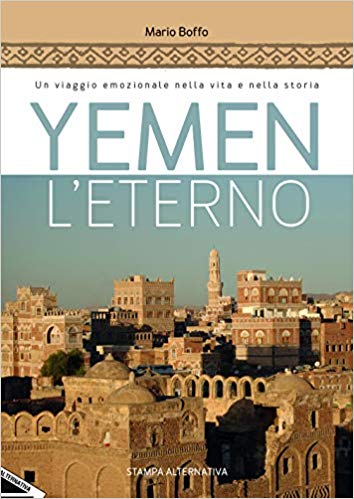 Lorsque tout va mal, il serait bon d’admettre les erreurs et de repenser les processus à mettre en place pour sortir de la confusion. Les tentatives maladroites de réparer trente années d’erreurs en quelques jours accroissent la confusion et sapent encore davantage l’autorité potentielle que l’Europe, malgré tout, mérite et qu’elle doit absolument reconstruire. Certainement pas avec les déclarations du président Macron : les deux cent quatre-vingt-dix bombes atomiques dont il semble disposer comparées aux six mille russes, ne semblent pas suffisantes pour une véritable politique de dissuasion, qui est finalement confiée non pas à un organe collectif mais à la décision discrétionnaire du président de la France lui-même. Et même pas sous la direction du Royaume-Uni, dont la trajectoire historique a toujours été d’empêcher toute croissance en Europe. L’inquiétude selon laquelle la Russie se prépare à attaquer l’Europe, et que nous devrions donc prendre des décisions d’urgence, ne semble pas non plus plausible.
Lorsque tout va mal, il serait bon d’admettre les erreurs et de repenser les processus à mettre en place pour sortir de la confusion. Les tentatives maladroites de réparer trente années d’erreurs en quelques jours accroissent la confusion et sapent encore davantage l’autorité potentielle que l’Europe, malgré tout, mérite et qu’elle doit absolument reconstruire. Certainement pas avec les déclarations du président Macron : les deux cent quatre-vingt-dix bombes atomiques dont il semble disposer comparées aux six mille russes, ne semblent pas suffisantes pour une véritable politique de dissuasion, qui est finalement confiée non pas à un organe collectif mais à la décision discrétionnaire du président de la France lui-même. Et même pas sous la direction du Royaume-Uni, dont la trajectoire historique a toujours été d’empêcher toute croissance en Europe. L’inquiétude selon laquelle la Russie se prépare à attaquer l’Europe, et que nous devrions donc prendre des décisions d’urgence, ne semble pas non plus plausible.
Certes, des inquiétudes inquiétantes pèsent sur la situation, comme la crainte d’une interruption de la couverture américaine de l’Alliance atlantique. L’Europe doit certainement s’y préparer ; elle aurait même dû commencer à s’y préparer depuis un certain temps. Mais la précipitation de ces jours n’aide pas. Voici donc cinq points alternatifs à ceux du sommet extraordinaire qui, dans la situation actuelle, seraient certainement plus productifs que ceux actuels :
- L’Europe suit de manière réaliste la cessation souhaitée des combats en Ukraine et s’engage, à partir de cette cessation, à entamer un large dialogue avec les États-Unis, la Russie et l’Ukraine elle-même afin de développer un projet de sécurité collective en Europe, collectivement garanti et visant l’équilibre et la paix ;
- consciente du rôle qu'elle aura à jouer à l'avenir pour sa propre sécurité et pour l'équilibre pacifique des puissances et des alliances, l'Europe entamera immédiatement un processus sérieux d'unification, en matière de politique générale et de défense, même sur une base partielle des membres qui entendent l'adopter ;
- le renforcement de la défense européenne, qui se développera sur la base du plus large partage industriel et stratégique, ne sera pas conçu contre un adversaire qui ne manifeste pas d'intentions hostiles, mais sera compris comme un instrument d'équilibre politique et militaire entre des pays et des groupes de pays qui souhaitent un développement pacifique des relations internationales ;
- malgré les mérites de la défense, l’Europe mettra l’instrument militaire au service de la diplomatie et de l’approche négociatrice des relations internationales ;
- L’Europe, en respectant et en réaffirmant ses principes fondateurs, poursuit la paix et la collaboration, ainsi que l’unité de but nécessaire pour résoudre les problèmes mondiaux.
Dans un tel cadre, qui combinerait l'indispensable réalisme avec la noblesse des principes, les besoins politiques et militaires avec le lancement d'un véritable projet unitaire, le pragmatisme imposé par les faits avec la vision idéale, un dialogue avec les Américains et les Russes devrait être engagé immédiatement. Sans l’arrogance de la puce, conscient des termes politiques minimaux et de la marginalité dans laquelle l’Union européenne est tombée après des décennies de bêtises, mais récupérant le bagage d’idées, de principes, d’attitude de dialogue que l’Europe possède aussi et dont elle a parfois fait preuve.
Aussi parce que, tandis que nous préparons l’avenir, et étant donné que les adversaires de l’Europe sont désormais des deux côtés, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler avec les deux, pour éviter de finir écrasés ; Si on le place au niveau de la confrontation armée, ou de la dissuasion, et en supposant qu'on commence à y travailler immédiatement, cela prendra au moins dix ans.
Mario Boffo, 12 mars 2025
in Transform! italia
In english
War and peace ?
Born in Naples, Mario BOFFO is an Italian diplomat and the author of several novels. He has served as ambassador in Yemen and Saudi Arabia, among other postings. He contributes to several journals, including LAB Politiche e Culture, a partner of I-Dialogos.
Wars have never ended with "just peace" agreements—mainly because “just peace” is not an absolute concept, but one that is perceived quite differently by opposing parties. Ultimately, it is a concept rooted more in propaganda than in reality. At the end of any war, there is always someone who wins and someone who loses, in the various ways that victory or defeat can be interpreted. There is only one just peace: the one born out of diplomatic handling of problems, a balance of power, shared security, mutual recognition and guarantees, control over the necessary military instrument, and the development of dialogue.
These factors can prevent and avoid wars. Or, they can rebuild peace after a war.As long as defeat is acknowledged, massacres and devastation do not persist without resolution; profound visions are developed regarding the relationships between countries and powers; and the problems and issues that triggered the war are brought back to the negotiating table. All this entails pain, compromise, and often long and exhausting negotiations; one must also accept impositions, since it is not always possible to negotiate on equal footing.In these terms, the many failures of the European Union over recent decades are glaring—since it abandoned the dialogue-based approach opened during the Gorbachev era, to instead align uncritically with NATO’s self-referential expansionist logic, led by the United States, toward Russia’s borders. Not the common house "from Vancouver to Vladivostok" hoped for by the historic Russian leader, but rather the gradual and ruinous collapse from Helsinki to Donbas.
Europe has missed many opportunities for growth, cohesion, and the development of a non-marginal international role. It could have attempted (albeit with difficulty) to resist NATO's expansionist push, by enhancing the logic and instruments of the OSCE, which directly stem from the Helsinki process. It could have more forcefully promoted a distinctly European identity within the Atlantic Alliance. It could have launched messages and initiatives for peace and cessation of hostilities at the eve or onset of the war in Ukraine. At any moment during these long thirty years, it could have reasserted the need to conceive of European security in collective terms.Admittedly, Europe neither had nor has the military strength nor political cohesion to impose all of this; but it could at least have acquired the authority needed to play a role as an interlocutor—over the years, and now again, at a time when discussions continue regarding the end of the war in Ukraine.
Even today, it could recover some of the lost time and scattered political messages from the past three decades, to regain a minimum of credibility. Instead, it produced the belated five points that emerged from the last summit, along with an agreement for costly, risky, and unplanned militarization.
The declaration of the extraordinary European Council in Brussels on March 6, approved by twenty-six members without the consent of Hungary’s Viktor Orban, reaffirms the principles that Europeans recognize as necessary to achieve a “just peace” in Ukraine:a
) there can be no negotiations about Ukraine without Ukraine;
b) there can be no negotiations affecting European security without the participation of Europe;
c) any truce or ceasefire must be part of a process leading to a comprehensive peace agreement;
d) any such agreement must be accompanied by strong and credible security guarantees for Ukraine, to help deter any future Russian aggression;e) peace must respect Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity.These principles, which would have been worthy of consideration and capable of influencing events in the immediate aftermath of the conflict’s outbreak, are now completely overtaken by events—given the American intention to end the war by any means necessary, even with a certain degree of brutality.
They now risk seeming out of touch, and completely at odds with what, like it or not, is happening.In truth, Europe today has neither the strength nor the authority to place these points on the negotiating table with any hope of success. Kyiv—and perhaps Europe—will likely appear in the final picture, but only after decisions have already been made by the American and Russian backers. The principles outlined in the five points, if asserted and more broadly developed around the mid-1990s or firmly proclaimed at the start of the war, might have had some success. Today, unfortunately, they are faced with an unpleasant reality—one that Europe itself helped create through decades of passivity and the blind stances taken at the onset of the armed conflict.
The rearmament proposed by von der Leyen suffers from the same decades-old inertia. A common European defense is an important issue—one that should have been considered at the end of the Cold War, when it became clear that U.S. security priorities would gradually diverge from Europe’s. (Trump’s uncivil and crude behavior is merely an acceleration of a process that had already begun.) However, common defense is not simply about how much to invest in arms, but about how countries collaborate—their military commands, defense industries; what intergovernmental or community structures to establish for defense management; what strategic concept to adopt; and how to break free from American suppliers by developing strong, collective research and European joint production.
Most importantly, we must know and decide what European defense is for: a united and cohesive Europe, or a grouping of loosely aligned and frequently quarrelsome countries?
Paradoxically, the investments advocated by von der Leyen, which will be made on a national basis only, will merely increase purchases of American weapons and entirely crush the hope of preserving any semblance of a welfare state on our continent. Moreover, Europe, armed as per Brussels' decisions, considering the divisions among its members and the absence—beyond rhetorical declarations—of a common vision, risks becoming even weaker. Without a genuine unifying project, it is not at all certain that the various members will truly pool their weapons to face future crises together.
So let’s call things by their name: we are increasing military budgets and buying more American weapons, in the (still uncertain) hope that the U.S. will not completely abandon us. Not a noble vision. Not a grand plan.When everything is going wrong, it would be wise to admit mistakes and rethink the processes needed to emerge from the confusion. Clumsy attempts to make up for thirty years of errors in just a few days only deepen the confusion and further erode the potential authority that Europe—despite everything—deserves and must rebuild.
Certainly not with President Macron's statements: the two hundred and ninety nuclear bombs he seems to have at his disposal, compared to Russia's six thousand, hardly seem sufficient for a genuine deterrence policy—especially when such a policy ultimately rests not with a collective body but with the discretionary decision of France’s president alone. Nor under the leadership of the United Kingdom, whose historical trajectory has always aimed to prevent any European consolidation.
The concern that Russia is preparing to attack Europe—and that we must therefore take emergency measures—also does not seem credible. Of course, serious concerns hang over the situation, such as the fear of losing American coverage under NATO.
Europe must prepare for that. In fact, it should have started preparing some time ago. But the rush of recent days is not helping.Here, then, are five alternative points to those from the extraordinary summit, which, in the current situation, would certainly be more productive:
- Europe realistically supports the desired cessation of hostilities in Ukraine and commits, starting from this cessation, to initiating a broad dialogue with the United States, Russia, and Ukraine itself to develop a collectively guaranteed European security project aimed at balance and peace;
- Aware of the role it must play in the future for its own security and for peaceful balance among powers and alliances, Europe will immediately begin a serious unification process—regarding general policy and defense—even among only the willing member states;
- The strengthening of European defense, developed through the broadest possible industrial and strategic sharing, will not be conceived as being against an adversary that does not display hostile intentions, but rather understood as an instrument of political and military balance among countries and groups seeking peaceful international relations;
- Despite the merits of defense, Europe will place the military instrument at the service of diplomacy and a negotiation-based approach to international relations;
- Europe, while respecting and reaffirming its founding principles, pursues peace and cooperation, along with the unity of purpose needed to address global challenges.
In such a framework—one that combines necessary realism with noble principles, political and military needs with the launch of a genuine unifying project, pragmatism with visionary ideals—a dialogue with the Americans and the Russians should be initiated immediately.
Without arrogance, conscious of the political limits and marginalization into which the European Union has fallen after decades of blunders, but recovering the wealth of ideas, principles, and dialogue-oriented attitudes that Europe still possesses—and has, at times, demonstrated.
All the more so because, as we prepare for the future—and given that Europe’s adversaries now lie on both sides—we cannot avoid speaking with both, lest we end up crushed. If placed on the level of military confrontation or deterrence, and assuming we start working on it immediately, it will take at least ten years.
Mario Boffo, March 12, 2025