
Christian Tremblay est président de l’Observatoire européen du plurilinguisme (OEP). Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, ancien élève de l’ENA (1982) et docteur en sciences de l’information (2002), il commence sa carrière administrative en 1972 au Ministère des finances, puis à la Mairie de Paris jusqu’en 2014. De 1975 à 1985 il a été collaborateur de Michel Jobert, ancien ministre des affaires étrangères de Georges Pompidou. En 1993, il entame une thèse de doctorat en science de l’information, en fait tridisciplinaire, linguistique, informatique et droit, L’apport de la modélisation des connaissances à la simplification et à la codification des textes normatifs, thèse soutenue en 2002. Il fonde en 2005, avec plusieurs partenaires, l’OEP et organise les différentes éditions des Assises européennes du plurilinguisme à Paris en 2005, Berlin en 2009, Rome en 2012, Bruxelles en 2016, Bucarest en 2019 et Cadix en 2022. Les prochaines auront lieu à Paris en mai 2026. Auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages, dont “Plurilinguisme, interculturalité et emploi : défis pour l’Europe” (2009) chez l’Harmattan, “L’impératif plurilingue, 18 ans avec l’OEP” (2022) et de plus d’une centaine d’articles autour du plurilinguisme et de la diversité culturelle, il dirige les sites Internet de l’OEP et de l’OPA (Observatoire du plurilinguisme en Afrique), la Lettre d’information de l’OEP et la collection Plurilinguisme. I-Dialogos est partenaire de l'OEP.
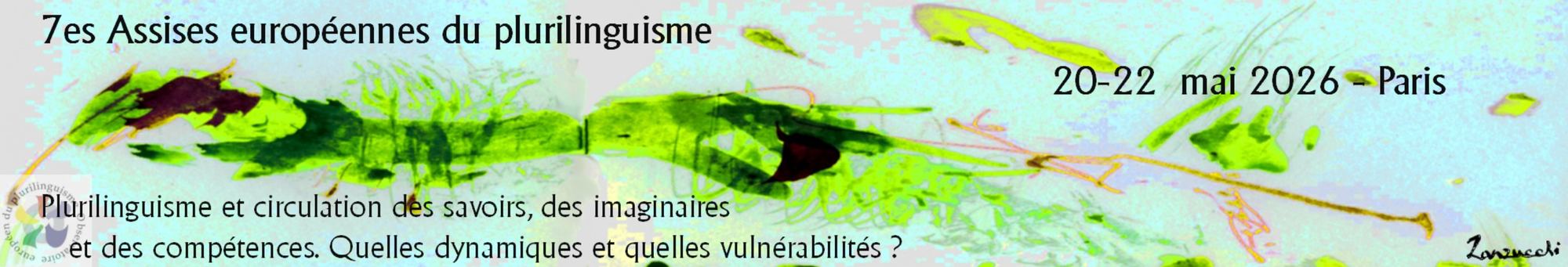
Dans un dîner-débat d’une belle tenue, mon interlocuteur me demande ce qu’est le plurilinguisme. Je lui réponds selon les canons habituels que le plurilinguisme est la capacité pour une personne d’utiliser de manière adéquate au moins une autre langue que sa langue première ou maternelle. Toutefois, cette réponse me paraît un peu courte et je me souviens d’une conférence tenue par Heinz Wismann en 2008 à Bruxelles dans laquelle il expliquait que si une langue pouvait à elle seule tout dire, alors on n’aurait pas besoin de la diversité des langues. Une seule langue pourrait suffire. Cette réflexion très philosophique n’a cessé de me poursuivre depuis lors, alors même que nous avions tenu les premières Assises européennes du plurilinguisme à Paris en 2005. Et c’est la réflexion qui est la trame de l’ouvrage que l’OEP vient d’éditer, De Babel à l’IA – Écrits sur le plurilinguisme
L’idée qu’aucune langue ne peut prétendre avoir la capacité de tout dire appelle un complément immédiat : c’est l’attention à l’autre, à ce qu’il est et à ce qu’il pense et dit, tout cela avec la relativité du point de vue. Point de vue qui n’efface pas le réel. La relativité du point de vue, n’est pas un relativisme absolu. 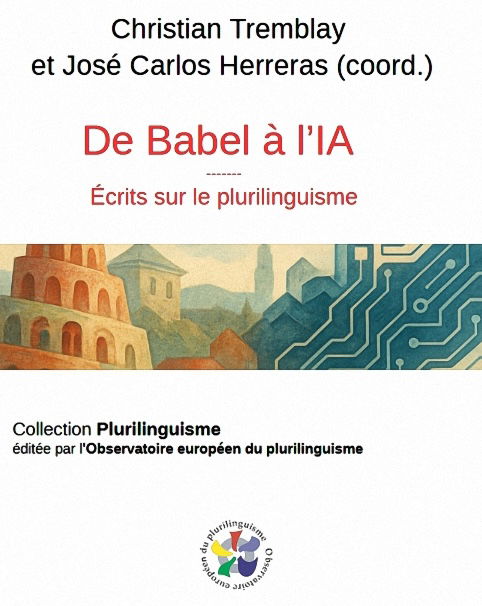
=> Le livre
Tout ceci semble d’une grande banalité. Pourtant le spectacle de tous les jours nous montre exactement le contraire, qu’il s’agisse des comportements individuels ou des relations internationales.
« La Vérité, c’est ce que je crois ». Que l’on passe au crible les déclarations individuelles privées et publiques, par des anonymes ou par des personnes publiques jusqu’à des chefs d’État, voire le chef d’État de la première puissance mondiale, on peut se rendre compte de l’absolue généralité de cette attitude. Cette formule a deux versions extrêmes : « Ce que je crois est La vérité et il n’y a qu’une seule Vérité ». En principe toutes les religions le disent. Ou bien, « A chacun sa Vérité ». Entre l’absolutisme et le relativisme absolu, il faut apprendre à naviguer.
L’esprit scientifique a perdu de sa superbe parce que l’on a cru que le réel avait des limites et que l’on parviendrait à tout comprendre. C’est faux. Le réel existe mais le Monde n’existe pas au sens où le monde est en ensemble fini à découvrir. Le réel reste une quête dont on essaie de s’approcher. Le véritable esprit scientifique est modeste. Et parce que la Vérité est un idéal inaccessible, on ne peut s’en approcher que par la recherche et l’argumentation.
Et l’essence même de l’éducation doit être cette attitude fondamentale par rapport au monde dans lequel on vit.
La conséquence de ceci est que l’on doit aux langues et à toutes les langues un immense respect.
Pourquoi ? Parce que les langues ne sont pas seulement des outils de communication. C’est vrai, elles servent en partie à cela. En partie seulement. Elles sont aussi le fruit de la confrontation de l’homme avec son environnement naturel, physique et social et de l’infinité de l’expérience humaine. Il n’est pas excessif de dire que dans chaque langue, il y a, selon l’expression de Wilhelm von Humboldt, une « vision du monde ». Les langues sont aussi des cultures. Diversité des langues et diversité des cultures sont inséparables. 
https://www.observatoireplurilinguisme.eu.
Nous ne sommes plus au temps des Grecs où le « barbare » était celui qui ne parlait pas le grec. Mais « barbare » voulait-il dire « sauvage » ? Rien n’est moins sûr. Alexandre n’a-t-il pas rencontré sur son chemin de grandes civilisations ?
Respecter les langues n’implique pas de les connaître toutes. Mais c’est certainement apprendre à les connaître quand la nécessité ou la simple utilité se présente. On peut le faire par une nécessité ou utilité pratique. Mais aussi parce qu’il y a tout un univers à découvrir. Aussi, parce que la relation avec l’autre s’en trouvera radicalement changée. Le niveau d’exigence peut être très variable bien sûr, entre les paroles de base de la vie courante et l’accès aux coutumes et à la littérature.
Essayons de transposer cela au niveau international.
La diplomatie ne commence-t-elle pas par la connaissance de l’autre ?
L’art de la guerre ne commence-t-il pas par comprendre les plans de celui que l’on désigne comme l’adversaire ?
Il y a des mots pour dire cela. Le culte de la puissance pour la puissance, se dit « impérialisme » et « unilatéralisme ». L’ouverture à l’autre et la recherche de l’équilibre des intérêts se disent « dialogue » et « multilatéralisme ».
Qu’est-ce que cela donne au plan des institutions internationales et européennes ?
En dépit des traités, l’Union européenne mêle un unilinguisme pratique fondamental à l’affirmation d’un multilinguisme de façade. Les pratiques et la symbolique de Bruxelles doivent changer.
Passons maintenant au plan économique.
Les atouts individuels du plurilinguisme commencent à être reconnus. Maintenant que la nécessité d’un minimum de connaissance de l’anglais comme lingua franca est largement reconnue, depuis le commerçant et la caissière de grande surface jusqu’au cadre supérieur, l’aptitude d’ajouter à cette langue standard une maîtrise suffisante de la langue du pays dans lequel on va travailler ou séjourner est une qualité dont la valeur commence à être reconnue. C’est un premier point.
Il y a beaucoup plus. Dans une société donnée il faut que la connaissance et les savoirs professionnels locaux dans des langues variées circulent, et il faut que les connaissances et les savoirs professionnels qui viennent du monde extérieur soient transposés et puissent nourrir et s’inscrire dans des dynamiques internes. Cela s’appelle la « linguistique du développement ». La « linguistique du développement » n’est pas un travail de savants, c’est aussi une discipline de terrain qui s’inscrit dans des dynamiques locales. C’est du plurilinguisme en action.
Continuons au plan de la recherche et de la science.
On a trop longtemps imaginé que la recherche était un processus de progrès linéaire. Que le progrès existe, personne ne peut le contester. Mais il n’est pas linéaire. On progresse sur certains plans, mais on peut régresser sur d’autres. Et le progrès n’est pas absolu. Il peut lui-même avoir des contreparties négatives. Tout cela est assez banal, mais pas suffisant. Il faut que ce que l’on vient de dire soit collectivement partagé, ce qui est loin d’être acquis. C’est pourtant la base des progrès futurs. Mais on n’a encore rien dit. La science, contrairement à une croyance tenace et peu scientifique, ne peut se dire en une seule langue. L’unilinguisme crée des biais scientifiques. Dans les sciences humaines, c’est une évidence. La découverte récente de textes non anglais en Australie a permis de mieux comprendre les origines et l’histoire de l’Australie moderne. Il en est de même dans les sciences dites dures, car l’on découvre que la créativité scientifique n’émerge pas dans la lingua franca, mais bien dans les langues maternelles ou premières qui portent en elles les cultures qui les ont vues naître et s’épanouir. D’où un vaste mouvement en cours pour une « science ouverte », c’est-à-dire une science qui ne nie pas mais qui s’appuie sur la diversité linguistique. Il y a nécessité d’une recherche plurilingue. Il ne faut pas avoir peur de parler de « domination ». Ce n’est pas un gros mot.
Quand vous créez quelque chose, vous exercez sans le vouloir une domination, même si le mot peut effrayer. La domination est dans la nature des choses. Il est inutile de la combattre par principe. Mais elle a évidemment des formes toxiques quand elle devient une fin en soi. On peut dire qu’elle apporte une dynamique positive indispensable en même temps qu’elle révèle des vulnérabilités. Il faut la valoriser mais en même temps la compenser. C’est toute cette délicate complexité qu’il convient de décrypter et de construire lors des 7es Assises que l’OEP organise les 20 au 22 mai 2026 à Paris.
Enfin, pour terminer, tout ce qui vient d’être dit doit se traduire au plan politique. Identifier quand elles existent les politiques linguistiques explicites ou implicites, les analyser, les critiquer, promouvoir celles qui valorisent la diversité et le respect des langues, défendre les langues européennes contre une anglicisation invasive tout en reconnaissant la valeur dynamisante des emprunts linguistiques d’où qu’ils viennent, c’est la vocation de l’OEP.
Dans ce qui vient d’être dit, nous avons volontairement écarté les références et les citations pour la bonne et simple raison qu’elles seraient beaucoup trop nombreuses.
On doit appeler l’attention sur l’originalité de la forme de notre ouvrage
De Babel à l'intelligence artificielle - Écrits sur le plurilinguisme. Il tient à la fois de l’essai et de l’anthologie. Il s’agit de faire parler de nombreux auteurs, anciens et contemporains et encore, pour beaucoup, bien actifs, autour d’un thème majeur à travers différents chapitres qui sont autant de mouvements, à la manière des « variations autour du thème de... ». Je reprends le compliment que nous a adressé notre très cher ami, Pierre Judet de La Combe, « ce livre est une vraie somme, théorique et historique. C’est magnifique ! » Comment ne pas en effet rechercher à reconnaître les nombreuses racines philosophiques et historiques du plurilinguisme, à savoir que la diversité est un état du monde indépassable, et en tirer ensuite toutes les conséquences, avec le concept lui-même dans son expression moderne posée par le Conseil de l’Europe, et ses diverses déclinaisons politiques, géopolitiques, éducatives, scientifiques, littéraires et poétiques et le ciment du tout que sont la traduction et le plurilinguisme.
Le plurilinguisme commence à avoir une très belle bibliographie et est aujourd’hui très présent dans le monde la recherche. Beaucoup de très bons auteurs ne se retrouvent pas dans cet ouvrage déjà copieux. Nous nous en excusons auprès d’eux. Nous nous retrouverons de toute façon, car il y a encore tant à faire pour faire passer le plurilinguisme du monde de la recherche à la vie de tous et de toucher les décideurs dans tous les domaines.
Christian Tremblay