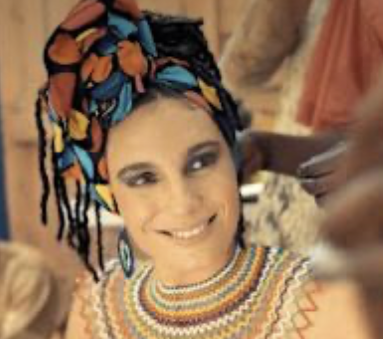
Installée à Poznan en Pologne, Iris Munos est Chanteuse-interprète, metteure en scène, formatrice, porteuse de projets artistiques, éducatifs et francophones. Fondatrice du programme Les Nuits du monde - festivals de chanson francophone, fondatrice de l’organisation culturelle L’Iris Création - Centre francophone de formation et de création artistique, co-fondatrice du projet 10/10 - pièces francophones à jouer et à lire. Elle dirige depuis sa fondation en 2011 Drameducation - Centre International de Théâtre Francophone en Pologne. Cela lui a valu d’être lauréate du trophée éducation des français de l’étranger organisé par « le petitjournal.com » en 2018.
Jean Claude Mairal pour I-dialogos : Iris, je vous ai rencontré récemment à Hérisson dans l’Allier, à l’occasion d’une réunion que j’avais avec Jan Nowak pour parler de projets francophones et littéraires que nous souhaitons développer dans cette commune rurale. Déjà que j’avais été surpris lors de ma première rencontre avec Jan, de voir un polonais amoureux de la langue française, développer avec une formidable énergie, des projets francophones dans son pays, je le fus encore plus, en découvrant que franco-allemande, avec des origines espagnoles, vous étiez dans la même approche, non en France, mais en Pologne, depuis 2011. Pourquoi la Pologne ?
Iris Munos : A 18 ans, j’ai participé à un échange de jeunes entre la France et la Pologne. La Pologne venait tout juste de rejoindre l’espace Schengen. Ce séjour en Europe de l'Est m’a profondément marqué. Le pays me semblait appartenir à un autre temps, la neige, le froid mordant, et surtout, des gens d’une grande chaleur humaine. Leur culture m’intriguait et me fascinait. Les jeunes polonais étaient désireux de découvrir, ils étaient curieux et heureux de se faire des amis. Ils avaient une haute estime des « petits français » que nous étions.
Malheureusement, le groupe de français s’est montré parfois désinvolte et égoïste. Le choc culturel avait frappé de plein fouet, et j’en ai eu très honte. Poussée par l’effet de groupe, je ne savais pas comment m’y prendre. Je me souviens du dernier jour où chacun devait partager son ressenti. Certains français affirmaient avoir créé de véritables liens d’amitié, mais dans le regard des polonais, un léger rictus trahissait leur politesse. Cette expérience comme beaucoup d’autres a influencé profondément mes choix futurs.
Quelques années plus tard, je suis retournée en Pologne. Et pour de nombreuses raisons, j’y suis restée. Je crois profondément que la rencontre est le moteur de la vie, ce qui pousse à aller de l’avant. A l’époque, l’idée de vivre une aventure un peu folle, de porter des projets improbables, me semblait plus sensée que de « croupir » en France, où je ne vois ni perspective ni espoir. Je faisais du théâtre comme comédienne et metteur en scène en France, mais je m’ennuyais. J’avais le sentiment d’être prise dans un tourbillon de consumérisme culturel et de passivité. Je tournais en rond. J’avais soif d’apprendre et de grandir. C’est ce qui m’a poussé à aller vers l’inconnu.

C’est en Pologne que j’ai découvert la francophonie. En France je ne savais même pas ce que c’était. Comme beaucoup d’autres, je n’en avais jamais entendu parlé. En découvrant qu’on pouvait construire de formidables projets autour de la langue française, à travers l’art et la culture en Pologne, j’ai décidé de rester… 10 ans. J’ai cette intuition, le flair. Je pressentais qu’il y avait là-bas quelque chose à vivre. Un pays dont personne ne s’intéressait, avec une culture à découvrir, un avenir à construire.
J’ai sillonné la Pologne avec une vieille voiture qui tombait souvent en panne, parfois à moins 20 degrés, pour animer des ateliers de théâtre en français dans les écoles. Les professeurs de français m’ouvraient grands leurs portes. Ces ateliers sont rapidement devenus, sans que je le planifie, des sortes de laboratoires pour une méthode d’apprentissage du français par le théâtre. Ne maitrisant pas encore le polonais, j’inventais des exercices pour me faire comprendre autrement. Parallèlement, j’organisais des festivals de théâtre pour étudiants de l’Europe de l’Est et Centrale, des tournées de spectacles francophones en langue française sous titrés en polonais, et je donnais des concerts avec des musiciens polonais, en reprenant les grands noms de la chanson française.
Les trois premières années ont été si intense que j’ai eu l’impression de vivre dix ans en trois. Alors pourquoi la Pologne ? Parce que je ne voyais aucune raison de revenir en France. Là-bas tout semblait possible. Je pouvais inventer, créer, proposer des projets qui n’auraient sans doute jamais vu le jour en France. Et aussi parce que la Pologne était alors un pays méconnu, souvent stigmatisé. On en parlait peu, ou alors à travers des clichés absurdes : des ours dans les rues, l’absence d’écrans plats, le communisme omniprésent, la misère généralisée…
J’y ai découvert des intérieurs d’une grande propreté, un goût marqué pour l’esthétique dans les cafés et les bars, une cuisine savoureuse, un engagement remarquable dans les arts, une énergie débordante dans les villes. J’ai reçu une véritable claque culturelle. Ce pays m’a fascinée, et j’ai voulu creuser plus loin. J’ai rapidement appris la langue pour mieux comprendre et échanger. J’ai été frappée par la gentillesse et la générosité du peuple polonais. Il y avait tant à faire, tant à construire.
A 24 ans, vivre une telle aventure, c’était exaltant. L’Europe regorge de trésors qu’on n’imagine même pas. J’ai été témoin du développement fulgurant d’un pays qui tente encore de se relever d’une histoire lourde. A ce moment-là, la France me semblait figée, désabusée. La Pologne, elle, débordait de jeunesse et de dynamisme.
Je suis persuadée que la Pologne deviendra un des pays le plus important de l’Union Européenne. Cela a même déjà commencé.
Jean Claude Mairal : Vous êtes installé à Poznan. Vous êtes Chanteuse-interprète, metteure en scène, formatrice, porteuse de projets artistiques, éducatifs et francophones. Fondatrice du programme Les Nuits du monde - festivals de chanson francophone, fondatrice de l’organisation culturelle L’Iris Création - Centre francophone de formation et de création artistique, co-fondatrice du projet 10/10 - pièces francophones à jouer et à lire. Vous dirigez depuis sa fondation en 2011 Drameducation - Centre International de Théâtre Francophone en Pologne. Cela vous a valu d’être lauréate du trophée éducation des français de l’étranger organisé par « le petitjournal.com » en 2018. C’est un engagement remarquable pour la francophonie ?
Iris Munos : C’est en invitant en Pologne des artistes issus de nombreux pays francophones que j’ai mesuré l’ampleur et la richesse de la francophonie. C’était immense et profondément exaltant. J’étais aussi lasse d’entendre toujours les mêmes clichés sur la langue française, que je ne prendrai pas la peine de répéter ici. Je n’en voulais à personne, mais pour moi, il devenait essentiel d’aborder la langue autrement. Ou plutôt les langues françaises. Multiples, nuancées, aux accents différents, présentes partout sur la planète.
Et je dois dire que je découvrais la francophonie en la vivant, au fil des projets, au fil du travail. L’ouverture au monde, en particulier chez les jeunes, était mon moteur. Ce monde si vaste, si riche et si complexe. Et pour intéresser les gens, la seule voie, selon moi, c’est la rencontre. Faire vivre un moment partagé avec un artiste belge, suisse, guinéen, québécois ou français : voilà le vrai choc culturel. Provoquer une émotion forte, autour d’un projet artistique où les jeunes sont à la fois acteurs et spectateurs, accompagnés d’une personne francophone d’une culture différente, c’était là, pour moi, la clef.
C’est ainsi que j’ai lancé, en 2014, un festival de théâtre francophone pour étudiants, où se côtoyaient des troupes venues de Biélorussie, d’Ukraine, d’Arménie, de Pologne, d’Albanie, et des invités professionnels francophones. Il n’y avait pas de prix à gagner : les jeunes venaient pour vivre des moments de rencontre intenses. Ce qui me touchait le plus, c’étaient ces échanges entre les spectacles, pendant les repas, les soirées, les pauses… Ces instants où chacun posait des questions : Qui es-tu ? D’où viens-tu ? Pourquoi es-tu là ? Et tout cela… en français. C’est cela que je cherchais. La rencontre.
Alors oui, on peut parler d’engagement. Parce que ces espaces de création sont aussi devenus des espaces de liberté, de dialogue, de compréhension du monde – pour les jeunes comme pour les adultes.
Depuis, j’ai poursuivi ce chemin à travers d’autres projets artistiques, éducatifs, pédagogiques. Leurs succès, et surtout l’expérience humaine qu’ils m’ont apportée, m’ont permis d’en développer de nouveaux, dans d’autres régions du monde.
Je ne me suis pas engagée pour la francophonie en tant que telle, mais pour des valeurs qui me sont chères : la diversité, la rencontre, le respect des différences culturelles. Il se trouve que ces valeurs sont au cœur de la francophonie. Et comme tous mes projets se déroulaient en langue française, cela a fini par s’imposer comme une évidence. Je peux dire aujourd’hui que je suis devenue profondément francophone… en Pologne.
Jean Claude Mairal : Mais en même temps il semble que la promotion de la langue française ne soit pas un long fleuve tranquille, en Pologne. Dans un entretien au « le petitjournal.com » en 2022, vous indiquiez « Je voudrais rajouter que la langue française est aussi pas mal considérée comme ringarde chez les jeunes (polonais). Or, la chanson française est pour moi synonyme de jeunesse, de révolte, de combat. C’est ce que je m’efforce de leur expliquer. » Brel et Gainsbourg sont pour vous les porte-étendards de la chanson française en direction du public et de la jeunesse ?
Iris Munos : Je comprenais très bien les jeunes Polonais. Ils recevaient une image de la France qui me semblait dater d’un autre temps… Une France que, moi-même, je ne reconnaissais pas. Pour beaucoup, la langue française restait figée dans les années 1950. Allez, parfois dans les années 2000, si je suis optimiste ! Stromae, puis Zaz, ont heureusement commencé à dépoussiérer un peu cette image. Mais on ne peut pas leur en vouloir : d’où viennent ces représentations ? Qui les véhicule ? Pourquoi ? Voilà les vraies questions.
Promouvoir la langue française et la francophonie, cela ne peut se faire sans moyens. C’est une question de volonté, bien sûr, mais aussi d’engagement… et de financement. Sans cela, on en reste à ce qui circule facilement : Piaf, Joe Dassin, Mireille Mathieu. Toute une génération passée, qui a certes marqué l’histoire, mais qui ne parle plus nécessairement aux jeunes d’aujourd’hui. Cette époque, c’était celle où les Polonais rêvaient de la France comme d’un pays de liberté. Mais le monde a changé. On vit aujourd’hui dans une réalité mondialisée, où les langues circulent autrement. L’anglais s’est imposé comme une seconde langue naturelle, et l’espagnol a gagné en popularité. La langue française, elle, a souvent été perçue comme figée, datée, sans avenir.
Alors oui, même Brel ou Gainsbourg peuvent sembler « ringards » aux yeux de certains jeunes aujourd’hui. Mais à leur époque, la chanson française incarnait quelque chose de fort : une révolte, une passion, une liberté. Cela ne suffit pas de les faire écouter. Il faut les faire vivre autrement. C’est ce que je m’efforce de faire : je les interprète à ma manière, avec des arrangements nouveaux, une présence scénique engagée, une esthétique plus actuelle. Il faut de la modernité dans la forme pour que le fond touche encore.
Et surtout, cela ouvre la voie à autre chose : connaître les anciens pour découvrir les nouveaux, pour établir une continuité. C’est exactement ce que propose le programme Les Nuits du monde : faire découvrir des artistes francophones contemporains aux jeunes d’aujourd’hui, en tissant des ponts entre générations, esthétiques, territoires. C’est là que réside la force de la chanson : dans sa capacité à dire le monde – à condition de la faire entendre autrement.

Jean Claude Mairal : Vous avez chanté "Et si Brel était une femme", notamment au Sénégal avec l'orchestre National du Sénégal et au Myanmar avec le Myanmar Contemporary Ensemble. Les vidéos de ces concerts, sont je vous l’avoue « bluffant » ! Je ne suis pas le seul à le penser. Il y avait une harmonie particulière et étonnante entre vous et ces ensembles issus d’autres cultures. Quelles sont vos impressions suite à cette singulière collaboration ?
Iris Munos : J’adore ce projet. Mais je ne vais pas mentir : ce n’est pas facile à réaliser. Il demande du courage, beaucoup de patience… et une immense capacité d’adaptation. Car la création, surtout dans un contexte international, est avant tout une aventure humaine. Les différences culturelles sont là, les visions du monde aussi, et il faut composer avec tout cela. Cela remet les pieds sur terre, très vite.
J’ai eu la chance – ou la folie – de collaborer avec des artistes de tant de nationalités, de cultures, de parcours différents… C’est vertigineux quand j’y pense. Et ce que j’en retire avant tout, c’est l’humilité. En tant que femme – jeune, seule, et souvent dans des pays où le patriarcat est très présent – ce n’est pas simple. Mais l’expérience acquise en Pologne, mes années de travail sur le terrain, m’ont forgée. Je dis les choses avec sincérité : très peu de personnes, hommes ou femmes, seraient allées au bout de certains projets que j’ai portés. Ce n’est pas de l’orgueil, c’est une réalité. Je suis souvent seule à piloter : artiste sur scène, mais aussi coordinatrice, communicante, productrice, négociatrice, diplomate. C’est lourd, c’est intense. Et il faut apprendre à faire tout cela avec respect, sans jamais laisser l’ego prendre le dessus.
Chaque projet, chaque destination est un apprentissage. Et si je pouvais faire un vœu, ce serait que chaque jeune, à sa manière, puisse vivre ce genre d’expérience. Même à petite échelle. Cela change la perception qu’on a du monde, des autres… et de soi-même.
Et si Brel était une femme est un projet exigeant. Mais c’est aussi un espace de liberté immense, un lieu de création totale. Je me donne à fond, corps et âme, et peut-être que c’est ce que l’on ressent dans les vidéos, dans les concerts. J’essaie toujours d’emmener mes partenaires dans mon univers. Pour cela, j’ai développé des méthodes, des approches, des codes qui me permettent d’établir une connexion. Et surtout, je me déplace vers eux. Ce n’est pas eux qui viennent dans mon monde, c’est moi qui entre dans le leur. J’apprends leur quotidien, j’observe leurs gestes, j’écoute leurs silences. Il faut trouver les bons mots, la bonne posture. Il faut du tact… et un peu de magie. Il faut faire rêver. C’est cela, la clé.
Avec l’Orchestre National du Sénégal, ce fut intense, parfois difficile, mais extraordinairement riche. Au Myanmar, ce fut plus doux, plus poétique, parfois bouleversant. Deux expériences très différentes, mais tout aussi précieuses. Je suis fière du rendu artistique, bien sûr, mais surtout profondément reconnaissante envers ces partenaires qui ont accepté de jouer le jeu, de sortir de leurs habitudes. Ce sont eux qui ont rendu cela possible.
Collaborer avec des artistes d’autres cultures, ce n’est pas instinctif. Ce n’est pas évident. Il faut un peu de folie, une grande ouverture, et l’acceptation de ne pas tout comprendre. Pourquoi se compliquer la vie, diront certains ? Mais c’est justement là que commence l’aventure. Ce genre de collaboration, c’est une forme d’éducation, bien au-delà de ce que nos familles ou nos écoles nous ont transmis. C’est un autre voyage. Comprendre l’autre, c’est d’abord reconnaître qu’on ne sait rien. Qu’il faut parfois juste se taire. Écouter. Et apprendre.

Jean Claude Mairal : Vous montrez que selon les espaces géographiques et les cultures, les spiritualités et l’Histoire propre à chacun d’eux, on peut donner à percevoir une vision et une conception de la francophonie et de la langue française, différentes, mais universalistes par le chant et la musique.
Iris Munos : Les thèmes de la vie sont universels. En Birmanie, la guerre a figé les esprits, les gens souffrent, l’économie est à genoux, l’avenir semble sans rêve. Au Sénégal, c’est la pauvreté qui érode les relations humaines, rend la sincérité plus rare, plus difficile à préserver. Mais ces réalités-là, on les retrouve partout : en France, en Pologne, en Ukraine, aux États-Unis. La musique, elle, transcende tout cela. Elle raconte ces douleurs et ces élans, elle les chante à travers des paroles, des mélodies, des interprétations qui touchent chacun, partout. Elle est un miroir de nos vies.
Et c’est là que la francophonie prend tout son sens : elle devient cette force qui rassemble les peuples autour de leurs souffrances, de leurs joies, de leurs espoirs, par-delà les langues. Le français, dans ce cadre, est un formidable outil de curiosité, d’ouverture, de lien entre les cultures. En Birmanie, par exemple, aucun musicien ne parlait français. Pourtant, au fil du travail, leur intérêt pour Jacques Brel, pour son univers, a grandi. C’est cela la magie : on n’a pas besoin de comprendre les paroles pour ressentir la force d’une chanson. L’émotion circule d’un corps à l’autre, d’un regard à l’autre. Et tout à coup, on est unis dans un moment suspendu. La francophonie, ce n’est pas seulement une langue partagée : c’est le respect profond des cultures, de toutes les langues, de toutes les histoires.
Dans mon travail de création, je reste fidèle aux chansons de Brel — les paroles, la ligne mélodique, les harmonies — mais je les habille autrement. Je les transpose dans d’autres esthétiques sonores en intégrant des instruments traditionnels, des rythmes locaux, des chœurs, des couleurs musicales inédites. Dans les clips Vesoul et Jojo tournés au Myanmar, on entend la flûte h’ne, la percussion mélodique patwaing, la harpe birmane saung-gauk qui semble venue d’un rêve. Cela donne une musicalité totalement inédite — oui, un peu dingue certainement— mais c’est ce que j’aime. Cette étrangeté pour nos oreilles occidentales est précisément ce que je cherche. Car ce projet ne parle pas qu’à l’Occident : il se déploie en Asie, en Afrique, et je veux que les musiciens qui y participent puissent y inscrire leur art, leur âme.
Et imaginez de leur côté : quelle fierté pour eux de présenter leur savoir-faire, de voir leur culture dialoguer avec celle de Brel, et que le résultat touche des publics très différents ! Pendant les répétitions, les échanges sont souvent profonds. On discute des accords choisis par Brel, de leur sens, de la liberté folle de ses paroles. Les musiciens sont souvent étonnés, intrigués, déstabilisés même, par la franchise du texte, par la manière dont la chanson française ose dire les choses. Et puis, l’émotion ne se vit pas de la même manière partout. Chaque pays a sa manière de la traduire, de l’exprimer, de la transmettre. C’est une richesse infinie. Parfois, un morceau ne prend pas — il reste à distance — et parfois, il nous dépasse tous. C’est imprévisible. Et c’est ça qui est beau : je me laisse surprendre à chaque fois.

https://www.liriscreation.com/
Je rends hommage à Brel selon qui je suis. Je ne peux pas faire autrement. Mon interprétation passe par mon individualité, ma culture. Et le fait d’être une femme occidentale dans ces contextes-là, cela suscite parfois étonnement, interrogations, voire jugements implicites. Il faut les assumer, les traverser, et transformer tout cela en force artistique. C’est un défi… mais aussi une grande aventure humaine.
Jean Claude Mairal : Vous m’écriviez récemment, que « le projet « Et si Brel était une femme » peut également toucher les musiciens et orchestres locaux de France avec les instruments de musiques propres aux territoires. Le projet voyage en résidence dans le monde entier, mais rien n’arrête le projet à rencontrer d’autres formations musicales de communes de l’hexagone. ». Nos lecteurs seraient heureux d’en savoir un peu plus ?
Ris Munos : C’est une question qui me touche beaucoup, parce qu’elle me ramène à mes racines. Oui, je voyage beaucoup à l’étranger, je collabore avec des artistes de cultures très différentes, et c’est une richesse incroyable. Mais je crois profondément que ce projet, Et si Brel était une femme, a aussi toute sa place en France. C’est mon pays, c’est là que je suis née, que j’ai grandi, et j’aimerais vraiment pouvoir mener ce projet dans des communes françaises, avec des groupes locaux, quels qu’ils soient.
Il ne s’agit pas forcément d’intégrer des instruments traditionnels au sens strict. Ce qui m’intéresse, c’est la diversité des styles, la créativité musicale, les personnalités. Ce qui compte, c’est de mettre en valeur les musiciens et leur univers, de faire dialoguer Brel avec d’autres esthétiques, d’autres sons. En Birmanie, par exemple, j’étais censée travailler au départ avec un groupe punk. Faire du Brel en version punk — ça m’aurait énormément plu, et je pense que ça aurait été très fort, à la fois drôle, libre et profond ! Malheureusement, ce groupe n’a pas pu participer. La junte birmane venait de décréter la conscription obligatoire, et beaucoup de jeunes ont fui vers la Thaïlande pour échapper à l’enrôlement militaire. Il allait de soi qu’ils devaient avant tout préserver leur liberté, leur avenir. Mais j’ai quand même pu coopérer avec deux autres orchestres incroyables, Myanmar Jazz Club et Inappropriate Thoughts, et ce fut une expérience magnifique.
Tout cela pour dire que je suis ouverte à tous les styles : rock, rap, reggae, électro, pop, musiques traditionnelles bien sûr… L’essentiel, c’est la sincérité de la démarche, l’envie de créer ensemble, de réinterpréter Brel tout en le respectant. Je ne cherche pas à l’imiter. Je chante ses chansons avec ma voix, ma sensibilité, et les arrangements que je propose vont dans ce sens. Je ne veux pas coller au passé, mais dialoguer avec lui.
Alors oui, en France aussi, il y a tant à faire. Il y a tant de musiciens talentueux dans les régions, dans les villes, dans les campagnes. Je serais ravie d’entrer en résidence dans une commune, de rencontrer un groupe local, quel que soit son style, et de construire ensemble quelque chose d’unique. Il suffit juste d’avoir envie, de partager les valeurs du projet, et de se lancer.
Jean Claude Mairal : Des propos positifs qui font du bien, expression de la vitalité des francophonies et de la confiance dans leur dynamisme. Des propos qui tranchent avec le pessimisme et le manque d’intérêt envers la Francophonie que l’on ressent en France. Que pensez-vous des propos de Yves Bigot, président de la fondation des Alliances françaises qui écrit, dans un hors-série de L’Eléphant, « La France est le seul pays qui ne s’intéresse pas à la francophonie », ce qui fait que les Français « ne mesurent pas combien la Francophonie et la langue française sont notre force. » Pour lui, et nous y adhérons complètement, « La conscience de la force de la francophonie est notre avenir. » Et il ajoute : « Pour la nouvelle génération, la Francophonie représente un avenir culturel et géopolitique, et un futur économique crucial. » Comment faire que les citoyens, les jeunes en particulier, les collectivités, les associations en France s’emparent et fassent leur la Francophonie?
Iris Munos : Comme je l’ai partagé un peu plus tôt, je ne savais même pas ce qu’était vraiment la francophonie avant de poser les pieds en Pologne. C’est dire ! Donc je comprends très bien ce que dit Yves Bigot, et je vois de quoi il parle. Cela dit, je ne pense pas que la France soit le seul pays à manquer d’intérêt pour la francophonie. Mais il est vrai que le lien entre les Français et la francophonie est complexe.
La langue française vient de France, oui, et on l’apprend gentiment à l’école. Mais la France a aussi un passé lourd avec ses anciennes colonies. Et ce passé continue d’imprégner les relations. Moi-même, ilm’est arrivé de me sentir mal à l’aise en me présentant comme française dans certains pays anciennement colonisés. Il y a parfois une gêne, des tensions, de la méfiance. Et on peut comprendre, des deux côtés.
En France, on se fiche souvent de la francophonie parce qu’on ne sait pas ce que c’est. On ne la voit pas. On ne la montre pas. Comme je disais plus tôt, même dans d’autres pays francophones, comme la Pologne, la langue française est trop souvent réduite à Paris, à la baguette et à l’image d’Épinal. Il nous a fallu travailler dur, vraiment, pour faire entendre qu’il existe des artistes francophones d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes… Et qu’ils ont des choses incroyables à dire, à partager.
En France, la francophonie est bien là. Mais on ne la nomme pas. Combien d’écrivains, de musiciens, de cinéastes francophones vivent en France ou y sont diffusés ? Beaucoup. Mais on dit « il est français, d’origine algérienne », ou « il vient de tel pays », sans jamais dire qu’il est francophone. Pourtant, c’est une richesse immense.
Mais cette richesse demande du travail. Elle demande de l’engagement. Ce n’est pas juste un mot qu’on clame pour faire joli. Si vous allez dans un petit village et que vous dites : « On va faire un projet francophone », les gens ne vont pas comprendre. Et je ne leur en veux pas, vraiment pas. J’étais comme eux. Ce mot ne voulait rien dire pour moi avant que je vive certaines expériences.
Ce qu’il faut, c’est proposer des projets concrets, qui parlent aux gens. Il faut leur dire : « On va faire de la musique, du théâtre, un atelier, un concert. » Et petit à petit, on tisse. On crée des ponts. Sans imposer. Sans forcer. Doucement. C’est un travail de fourmi, mais c’est comme ça qu’on y arrive.
Et puis, il faut changer notre regard. En France, on a parfois un complexe de supériorité. On parle des autres comme s’ils venaient « d’ailleurs ». Mais pour ces autres, c’est nous, les Français, qui venons d’ailleurs. C’est ça aussi, la francophonie. C’est comprendre que chacun a son accent, son histoire, sa sensibilité… et que c’est précisément cette diversité qui est notre force.
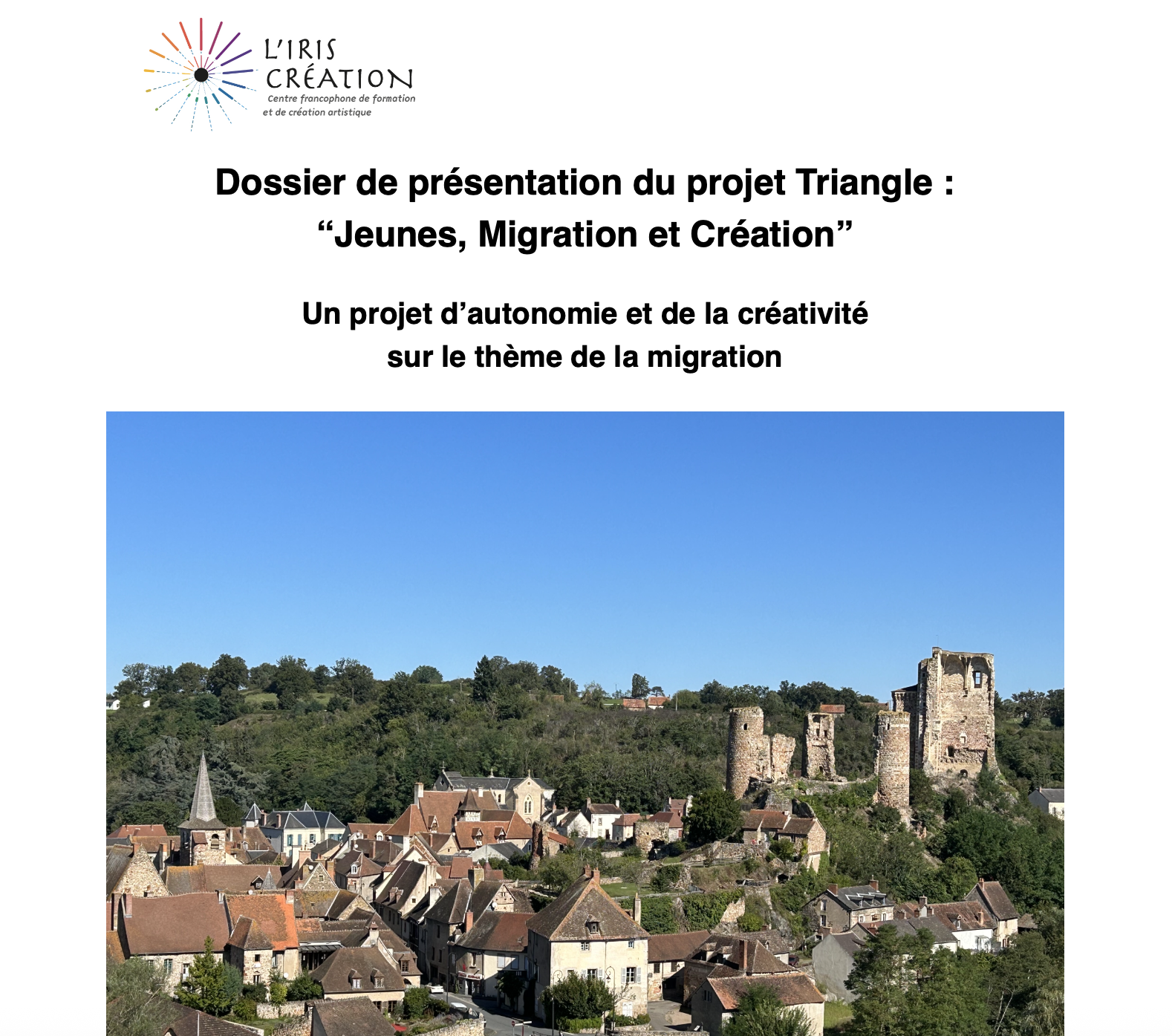
Présentation du projet Triangle
Jean Claude Mairal : Cela rejoint les propos de Walles Kotra Originaire de l’île de Tiga en Nouvelle-Calédonie, qui a été directeur exécutif chargé de l’Outre-mer au sein du groupe France-Télévisions et qui parle de la France comme d’un « Pays-Monde » qui pourtant se « refuse de se penser en archipel mondial pour continuer à n'être qu'un Hexagone rabougri, incapable d'assumer sa géographie éclatée et ses champs culturels multiples". En effet, grâce à la Francophonie et à ses territoires ultra-marins, présents sur les grands océans, la France peut être considérée comme un Pays-Monde, dont nos concitoyens et la plupart des élites n’ont pas conscience, préférant pour celles-ci ne regarder que leur nombril ou le bout de leurs chaussures.
Iris Munos : Mais comment se fait-il qu’on ne sache rien, ou si peu, des Caraïbes en France hexagonale ? Il y avait pourtant cette chaîne sur la diversité culturelle, France Ô, qui relayait les nouvelles des Outre-mers. C’était une vraie fenêtre sur d’autres cultures, sur des territoires dont on ne parle jamais dans les médias nationaux. Et puis… on l’a supprimée.
J’ai eu la chance d’aller en Guyane française, et de travailler un peu avec des Amérindiens grâce à un partenariat local. Il fallait prendre la pirogue pendant plus de quatre heures pour atteindre leur village. J’ai rencontré là-bas des Amérindiens français. Oui, français. Et pourtant, qui parle de la Guyane en France ? Qui connaît vraiment ce territoire ? Sa biodiversité est exceptionnelle, ses cultures sont profondes, son histoire passionnante. Mais on n’en parle jamais. On regarde notre petit nombril, comme vous le disiez. On regarde l’Hexagone, uniquement l’Hexagone.
Les Français passent une bonne partie de leurs vacances dans leur propre pays. J’ai vécu en Pologne, et là-bas, les gens voyagent beaucoup à l’étranger. Ils ont une vraie soif d’ailleurs, d’Europe, du monde. Peut-être parce qu’ils ont été privés de cela pendant des décennies. Du coup, ils idéalisent souvent l’étranger, ils pensent qu’ailleurs, c’est forcément mieux. Combien de fois m’a-t-on demandé, très sérieusement : “Mais pourquoi vous vivez en Pologne ? Vous êtes presque folle !” C’est un vrai étonnement pour eux.
Est-ce que les Français réagiraient pareil à un étranger qui s’installe en France ? Non. Ils diraient plutôt : “C’est normal que tu viennes ici, la France est le plus beau pays du monde. Et c’est normal que tu parles français.” Mais ce n’est pas grave. Chaque peuple a son histoire, son chemin, ses blessures, ses fiertés. On ne peut pas juger. En faire le constat, oui. Mais juger, non.
Moi, je ne doute pas que la francophonie puisse avoir sa place en France. Elle y est déjà, en réalité. Il faut simplement lui donner un nom. Mettre les mots. Il faut travailler dur pour cela. Ne pas forcer. Y aller doucement. Être engagé. Rappeler que nous ne sommes pas seuls. Que parler français, ce n’est pas seulement parler comme en Île-de-France. C’est parler avec un accent haïtien, sénégalais, québécois, calédonien, ou bruxellois. Et c’est ça qui est beau.

Jean Claude Mairal : En fait la francophonie n’est-elle pas une autre voie pour accéder au Monde, comme Gilles Vigneault pour qui « La francophonie, c’est un vaste pays, sans frontières. C’est celui de la langue française. C’est le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous. »
Iris Munos : Oui, exactement. La francophonie, c’est bien plus qu’un ensemble de pays qui partagent une langue. C’est une autre façon de regarder le monde, de le ressentir, de le traverser. Quand j’étais en Pologne, je voyageais en permanence — sans jamais quitter le pays. Je voyageais en moi, à travers les histoires, les émotions, les rencontres. Je voyageais par les livres, les musiques, les pièces de théâtre, les films. La langue était une passerelle. Mais ce qu’il y avait de l’autre côté, c’était des mondes entiers.
On oublie souvent que la langue ne sert pas seulement à parler ou à écrire. Elle sert à relier. Et parfois, on est lié sans même avoir besoin de comprendre tous les mots. Une chanson francophone peut toucher quelqu’un qui ne parle pas français. Une image, un rythme, un mot chanté avec émotion : c’est déjà une rencontre.
Mais voilà : pour accéder au monde, encore faut-il le rencontrer. Il faut provoquer la rencontre. Pas attendre. Pas espérer que ça se fera tout seul. Depuis des années, je travaille pour que les jeunes aient cette chance-là. Car c’est eux qui feront le monde de demain. Ils sont déjà en train de le rêver. Il faut juste leur donner les moyens de le construire avec les autres.
Aujourd’hui, il est facile de croire qu’on connaît le monde parce qu’on le voit défiler sur nos écrans. Mais on ne rencontre pas un pays ou une culture dans une vidéo de trente secondes. On rencontre quand on mange ensemble, quand on crée ensemble, quand on écoute ensemble. C’est pour ça que je mets toute mon énergie dans des projets d’échange et de création artistique. Cet été, par exemple, on accueille dans un petit village de l’Allier des jeunes venus de France, du Togo et d’Allemagne. Ils vont faire du théâtre, de la musique, de la vidéo, accompagnés d’artistes francophones. Et puis en 2026, ce sera à leur tour de partir, en Allemagne, puis au Togo.
Je veux croire que parmi eux, certains vivront cette même révélation que j’ai eue à 18 ans en posant le pied en Pologne. Cette ouverture, ce vertige, cette joie d’être soudain relié à quelque chose de plus vaste. Je ne peux qu’espérer que ces jeunes repartiront avec une lumière nouvelle en eux, une confiance, une curiosité. Et qu’ils grandiront avec cette conscience : le monde est là, immense et beau, et il nous attend.
Jean Claude Mairal : En lien avec les territoires ultra-marins français, il m’est souvent difficile de parler de la francophonie dans ces territoires. Isabelle TESTA, référente langue vivante régionale dans l'académie de la Réunion, m’écrivait : « Il me semble que le concept de francophonie sous-entend une hiérarchie des locuteurs, donc des langues. D'où la difficulté à mon sens de faire une place aux langues régionales pour ce qu'elles sont en tant que langues dotées de toutes les fonctions langagières, et en non en comparaison avec une langue qui reste langue de prestige. » Mais cela n’est pas propre aux Outre-Mer français, mais à tous les pays qui ont des langues régionales. «Chez tout être humain, écrit Amin Maalouf, existe ce besoin d’une langue identitaire. Chacun de nous a besoin de ce lien puissant et rassurant. Mais il faut entendre dans ce mot d’identité, surtout chez vous, non pas une identité contre, une identité meurtrière, mais une identité avec, qui ajoute, qui grandit, qui multiplie. Et là est précisément la force du français. Nous avons besoin de toutes ces langues, et d’une langue qui soit la même de Lille à Nouméa, de Marseille à Pointe-à-Pitre, pour nous sentir appartenir à la même entité nationale en nos différences. ». Sabah Rahmani Journaliste, anthropologue, consultante, autrice du livre Paroles des peuples racines (Actes Sud, 2019), n’a-elle pas raison quand elle écrit : « En contribuant à la valorisation, aux échanges, à la communication et la collaboration des langues de France, les projets de la francophonie aux côtés des langues ultramarines peuvent ainsi participer à l’amélioration du vivre ensemble entre citoyens. Car plus la langue nationale et institutionnelle, ici le français, valorisa ces langues minoritaires, plus les citoyens de ses territoires seront aussi en mesure de valoriser la culture française et d’encourager l’apprentissage de sa langue. Ne voyant plus l’Etat comme un potentiel « danger » de sa culture ancestrale qui menace sa langue, mais comme un allié « protecteur ». A l’instar de la richesse de la biodiversité et de l’urgence sa préservation, la diversité linguistique et culturelle dans le monde, est essentielle à la construction d’un monde plus pacifié. La francophonie peut donc jouer un grand rôle pionnier et fédérateur. » ?
Iris Munos : Ce sujet est très sensible. Je ne suis pas une spécialiste non plus, mais je partage ce que j’observe, ce que je vis. Dans les territoires ultra-marins, comme dans certains pays africains, on sent encore fortement cette perception de la langue française comme langue imposée. C’est une réalité historique. Et tant qu’on n’aura pas reconnu, vraiment, la valeur des langues locales — qu’on ne leur donne pas la même dignité — il sera difficile de construire une francophonie vécue comme une richesse partagée.
Je crois profondément, comme vous, que la francophonie pourrait être un lien. Mais pour cela, elle ne doit pas gommer les autres langues. Elle doit les inclure, les respecter, les faire vivre. Sinon, on est dans un modèle qui a l’air d’être basé sur l’ouverture mais qui reproduit en fait des hiérarchies anciennes.
Il faut sortir de cette idée d’identité contre, de langue contre. Ce n’est pas parce qu’on parle français qu’on doit taire ou oublier sa langue d’origine. Au contraire. La langue française ne doit pas être une menace, mais une passerelle. Un espace commun où toutes les autres langues sont invitées.
Et ça, oui, ça demande des décisions politiques fortes. Des lois, des budgets, des formations. Mais ça commence aussi avec nous. Avec les artistes, les enseignants, les citoyens. Dans nos spectacles, dans nos échanges, dans nos choix. Quand je chante ou fais chanter des chansons de Brel dans différents pays, je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. J’ouvre juste un espace de dialogue. Et parfois, ces chansons sont traduites, adaptées, ou même chantées à côté d’un chant local, dans une autre langue. Et là, il se passe quelque chose. Un respect, une émotion, une reconnaissance.
Alors oui, la francophonie peut être un outil de rassemblement. Mais pas si elle efface. Seulement si elle ajoute, si elle valorise, si elle fait de la place. Comme dans un orchestre : chaque instrument compte, chaque timbre enrichit l’ensemble. Et le français pourrait être cette musique commune qui relie sans dominer.
À nous d’en faire quelque chose de vivant, de juste, de joyeux.
Jean Claude Mairal : Pour conclure notre entretien, ne serait-il pas temps de changer de logiciel concernant la Francophonie, de donner un nouvel élan à celle-ci pour construire avec les peuples et les territoires, une francophonie du 21ème siècle ? Que faudrait-il mettre en œuvre pour que l'ensemble de nos concitoyens et des décideurs prennent conscience de la force que représente la Francophonie pour la France?
Iris Munos : La francophonie ne peut pas rester une idée figée, elle doit se transformer avec son temps, avec le monde. C’est une force incroyable, mais encore faut-il lui donner les moyens de l’être. Et cela passe, très concrètement, par des projets, des échanges, de la circulation. Pas uniquement des idées. Il faut que les décideurs comprennent que la francophonie, ce n’est pas juste une question de langue : c’est une stratégie d’avenir. Elle crée du lien, elle génère du sens, elle ouvre des portes.
Mais pour cela, il faut oser. Oser sortir d’une vision franco-française, centralisée, descendante. Oser faire confiance à la jeunesse. Oser donner les clés aux artistes, aux enseignants, aux scientifiques, à celles et ceux qui créent des ponts. Oser prendre le risque d’une francophonie qui écoute au lieu d’imposer, qui accueille au lieu d’uniformiser. Et oser investir pour cela. Vraiment. Pas des miettes.
Les artistes, les éducateurs, les jeunes… ils ont besoin de perspectives. De stabilité. Pas seulement d’un événement une fois par an, mais d’un engagement durable. C’est possible. Il y a des festivals, des échanges, des laboratoires d’idées. Il y a des talents immenses dans tous les pays francophones. Mais il faut que ces talents puissent se rencontrer, travailler ensemble, créer. Sans être freinés par des frontières, des visas, des silences administratifs. La culture est un levier de transformation. Et elle est une des plus belles expressions de la francophonie. C’est par elle qu’on rêve, qu’on partage, qu’on se comprend. Ce projet Brel, que je porte avec passion, est un exemple : il n’a de sens que parce qu’il est collectif. Parce qu’il s’ancre dans les réalités locales. Parce qu’il valorise les différences. Et parce qu’il parle d’humanité. Alors oui, il est temps de changer de logiciel. De passer d’une francophonie institutionnelle à une francophonie vécue. Une francophonie qui circule, qui s’incarne, qui fait du bien. Et qui donne envie.