
Abdoulahi ATTAYOUB est, à Lyon, le président de l’Organisation de la Diaspora Touarègue en Europe (ODTE) / Tanat. Il est aussi Consultant en relations internationales (Sahel) et membre du Réseau I-Dialogos.
Niger : deux ans déjà !
Le 26 juillet 2023, le Niger basculait brutalement dans l’incertitude politique. Le président élu Mohamed Bazoum était évincé par un coup d’État militaire, dont les zones d’ombre demeurent, deux ans plus tard, toujours aussi épaisses. Derrière ce putsch, certains voient la main de l’ancien président Mahamadou Issoufou, évoquant un jeu d’alliances et de rivalités internes mal maîtrisé. Une hypothèse qui alimente les tensions au sein même du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), tiraillé entre courants divergents et ambitions contradictoires.
Deux années se sont écoulées. Et pourtant, la promesse d’une transition structurée, capable d’ouvrir une nouvelle ère politique, semble aujourd’hui dissoute dans un discours souverainiste souvent excessif et parfois contreproductif. Loin d’un processus ordonné de refondation, le pays évolue dans une zone grise institutionnelle, sans cap clair, sans échéancier crédible, sans projet cohérent.
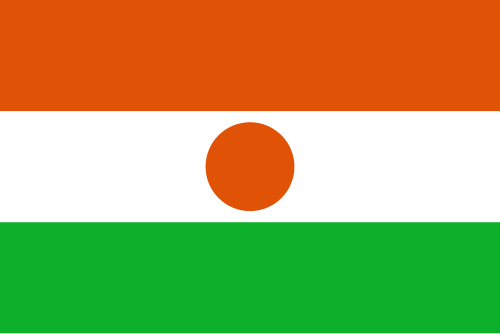 Une transition sous tension
Une transition sous tension
Le CNSP, organe militaire s’étant emparé du pouvoir, est rapidement passé du langage de la rupture à celui de la rente politique. Le discours patriotique, teinté d’une rhétorique de rupture avec l’ordre ancien et les puissances étrangères, a servi de paravent à une gestion du pouvoir marquée par le repli, l’improvisation, et la personnalisation de la décision. Le pays s’est progressivement isolé de ses voisins et de ses partenaires traditionnels, rompant des alliances sans en bâtir de nouvelles réellement viables.
À l’interne, la machine de la refondation tourne à vide. Les institutions transitoires attendues, garantes d’un retour à l’ordre constitutionnel, tardent à voir le jour. Le Conseil consultatif de transition (CCR), présenté comme l’organe de dialogue et de représentation nationale, s’est avéré n’être qu’un cénacle de partisans du régime, récompensés pour leur loyauté plus que pour leur légitimité. Sans réel pouvoir, son rôle reste flou, sa mission obscure, et sa pertinence contestée. L’utilité de ce Conseil est en effet loin d’être une évidence et se présente au contraire comme une anomalie institutionnelle budgétivore en décalage total avec les attentes d’un peuple en proie à de graves incertitudes.
Le projet AES : entre précipitation et opacité
L’adhésion hâtive du Niger à l’Alliance des États du Sahel (AES), aux côtés du Mali et du Burkina Faso, illustre les errements d’une diplomatie devenue trop idéologique. Ce projet d’intégration régionale, aussi ambitieux que mal préparé, aurait mérité un débat national, une concertation élargie, et une planification rigoureuse. Au lieu de cela, slogans et décisions à l’emporte-pièce ont pris le pas sur le pragmatisme nécessaire à une véritable refondation géopolitique. La mise en place d’une confédération, présentée comme un horizon stratégique, ne peut se faire sans l’adhésion explicite et informée de l’ensemble des populations concernées.
Par ailleurs, la création de cette alliance, autour de réalités propres aux trois pays membres, ne devrait pas se concevoir comme alternative à l’actuelle Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui devrait demeurer, à une autre échelle, le cadre sous régional d’intégration économique en cohérence avec les autres parties du continent.
Isolement régional, tensions internes
Sur la scène régionale, le Niger paie aujourd’hui le prix fort de ses ruptures intempestives. Les relations avec ses deux géants frontaliers, le Nigeria et l’Algérie, sont au plus bas. La fermeture prolongée de la frontière avec le Bénin constitue un contresens diplomatique et économique, dont les conséquences pèsent lourdement sur les circuits d’approvisionnement et les conditions de vie des Nigériens.
Le populisme qui entoure ces décisions masque difficilement l’absence de vision stratégique. Revendiquer la souveraineté ne saurait se faire au détriment de l’intérêt national. Or, le Niger semble évoluer dans une logique d’affrontement plutôt que de coopération, se coupant de leviers essentiels à sa stabilité et à son développement.
Le Niger devrait conserver son rôle de pôle de référence en matière de stabilité dans la sous-région. Ce marqueur de sagesse et de pragmatisme doit être préservé en dépit des vicissitudes politiques internes actuelles.
Une impasse politique et sécuritaire préoccupante
Deux ans après le putsch, les Nigériens sont toujours dans l’attente d’un véritable projet politique. Les espoirs nés de la promesse d’une gouvernance vertueuse, débarrassée des travers du passé, clientélisme, corruption, exclusion, s’étiolent. Le pays donne l’image d’un pouvoir replié sur lui-même, sourd aux aspirations populaires, et prisonnier d’une logique de survie.
Malgré des promesses de lutte renforcée, le CNSP peine à inverser la tendance sécuritaire. Les régions comme Tillabéri, Tahoua ou Dosso échappent de plus en plus au contrôle de l’Etat, laissant la population à la merci d’exactions de toutes sortes.
La situation de Mohamed Bazoum, maintenu en détention depuis son renversement, cristallise cette impasse. Au-delà de la dimension humaine, c’est le respect du droit et des principes républicains qui est en jeu. Une sortie apaisée, respectueuse des fonctions qu’il a occupées, s’impose comme une nécessité politique et morale.
L’appel au sursaut
Le Niger est à la croisée des chemins. Dans un contexte régional et international de plus en plus instable, l’heure exige lucidité et à la responsabilité. Le pays ne peut se permettre un naufrage politique prolongé, au risque d’aggraver les souffrances d’une population déjà éprouvée par l’insécurité et la crise économique. Un sursaut national s’impose, porté par les élites politiques, intellectuelles et sociales, pour remettre le Niger sur les rails d’un avenir possible.
Il est encore temps de sauver l’essentiel : la stabilité, la cohésion nationale, et la dignité d’un peuple en quête de justice, de sécurité et d’un État enfin au service du bien commun.
Abdoulahi ATTAYOUB