
Charles JOSSELIN a occupé les fonctions de Secrétaire d’État aux Transports, puis de Secrétaire d’État à la Mer. Il a ensuite été Ministre de la Coopération de 1997 à 2002, sous la présidence de Jacques Chirac. C’est à ce titre qu’il nous a confié cette interview. Charles Josselin a laissé une empreinte durable, en particulier sur le continent africain tant par sa vision de la Diplomatie qui ne peut plus être limitée aux seules relations entre États que par les relations qu’il a su nouer avec ses interlocuteurs sur le terrain, comme lors des grandes Conférences internationales. Convaincu que les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer dans les grands défis globaux et pour rapprocher les peuples Charles Josselin fut un précurseur et promoteur de la « coopération décentralisée ». La diplomatie doit s’enraciner dans les villes et les régions, plus proches des citoyens. Il a ainsi développé des actions de coopération décentralisée en tant que président du Conseil général des Côtes-d’Armor, avec plusieurs collectivités étrangères : Gabès (Tunisie), Agadez (Niger), Olsztyn (Pologne), Ha Tinh et Nghe An (Vietnam), Liège (Belgique), … Il a également été maire de Pleslin-Trigavou, Député, Sénateur, et siégé au Parlement européen. Il a ensuite présidé Cités Unies France (FMCU), avant d’en devenir président d’honneur. Aujourd’hui en retrait de la vie publique, il suit toujours de près l’actualité géopolitique. PH
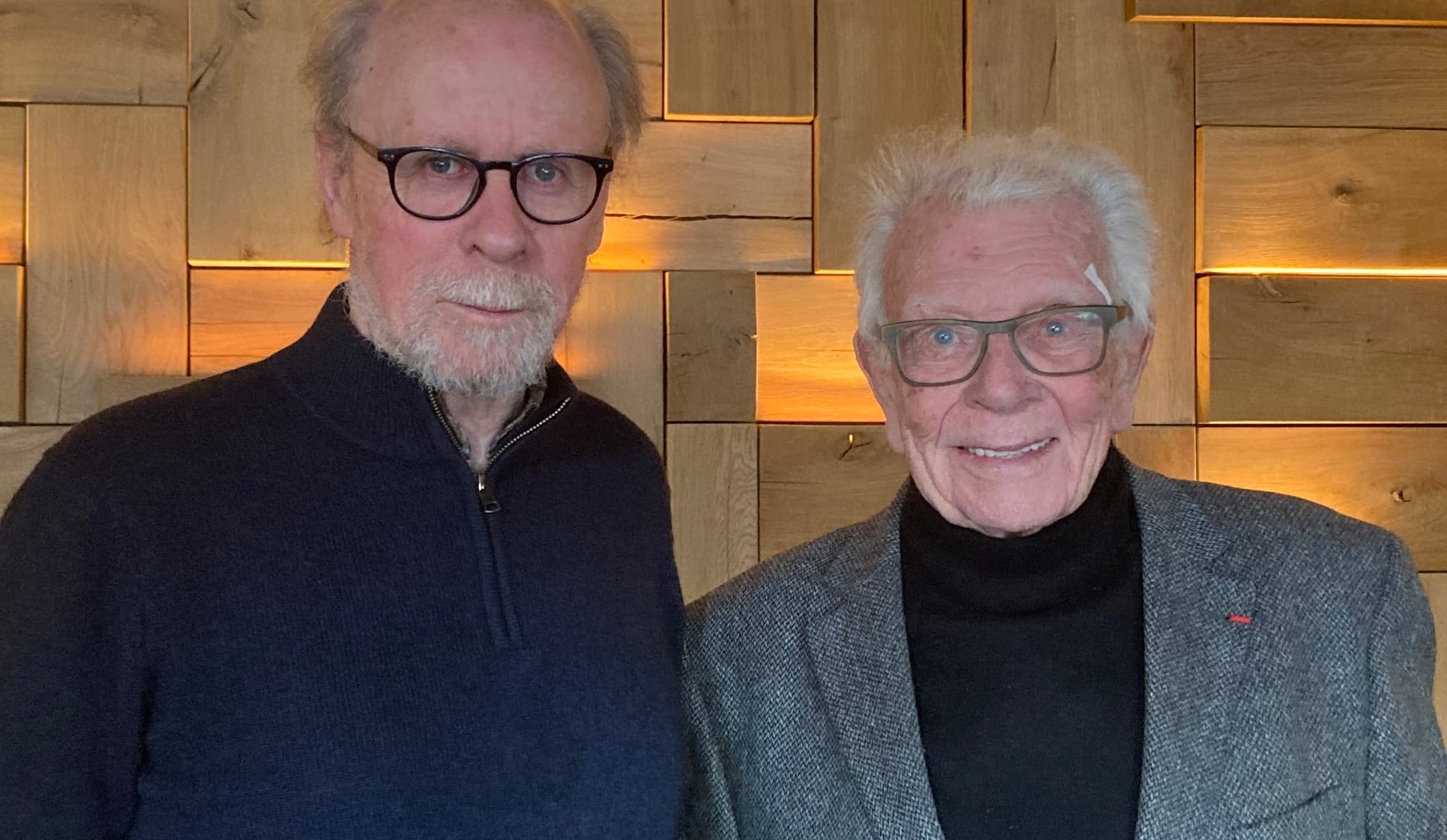 Charles Josselin et Pierrick Hamon, Paris, été 2025
Charles Josselin et Pierrick Hamon, Paris, été 2025
I-Dialogos : Charles Josselin, comme ancien ministre de la coopération et de la Francophonie, que pensez-vous, après le Sommet de Villers-Cotterêts, du débat autour de l’avenir de la Francophonie, notamment en Afrique ?
Charles Josselin : Même en Afrique, et peut-être plus qu’ailleurs, l’eau a coulé sous les ponts, ceux de l'histoire. N’est ce pas Aimé Césaire qui considérait la Francophonie comme une richesse trouvée dans les décombres de l'empire colonial ?
Il y a incontestablement un déclin de la francophonie, ou plutôt un déclin d’une certaine conception de la Francophonie, celle de la Francafrique. C’est principalement la décolonisation qui est à l’origine de ce déclin avec l’autorisation obtenue de parler une autre langue que le français. Parmi les raisons de ce déclin, il y a la fin du service national qui permettait à 30 000 coopérants, véritables « hussards de la francophonie », de faire le choix de l'expatriation éducative et sanitaire, plutôt que celui du port des armes.
Les écoles sahéliennes en ont été les premières victimes. Et puis, en Afrique comme ailleurs, et même en France, l'américanisation a submergé la francophonie. Cela avait commencé au moment de la guerre 14 18 avec l’entrée en guerre des Etats-Unis.
En l'état actuel, la Francophonie est surtout l'objet d'une politique de communication. 56 pays sont déclarés membres de l’OIF auxquels ils convient d’ajouter 5 associés et 32 Etats observateurs dont bien peu sont réellement francophones. Je note ainsi que le Qatar et quelques autres pays avec lesquels nous sommes en affaires, les ont rejoints. Même parmi les pays officiellement membres, j'en connais plusieurs pour qui la Francophonie c’est de l’histoire ancienne.
Le choix fait par le Président Macron de confier la direction de l’Organisation Internationale de la Francophonie à la représentante du Rwanda qui a fait le choix de l‘anglais contre le français, en perturbe pour le moins la compréhension. Le président Kagamé n’hésite pas, ces temps-ci, à maltraiter, c’est le moins que l’on puisse dire, son grand voisin francophone, en engageant son armée au Congo RDC, en appui au M23, dument mandaté. Nos protestations le laissent complétement indifférent.
C'est pourtant le moment que la France choisit pour apporter son soutien à la programmation, à Kigali, en novembre prochain, de la 46ème Conférence ministérielle de la Francophonie. C'est une insulte faite au Congo qui est le plus grand réservoir, et pas seulement en Afrique, de locuteurs francophones. Plus qu’en France. Il est vrai que les capitales africaines susceptibles de pouvoir accueillir un tel évènement se sont raréfiées. On n’imagine pas qu’il puisse être organisé aux Comores ou à Djibouti ou même en Centrafrique. Même le Gabon et le Sénégal ont changé de sensibilité, sans parler de la Tunisie et de l’Algérie où ce n’est sans doute pas le bon moment.
 Le 36ème Sommet de l'Union Africaine
Le 36ème Sommet de l'Union Africaine
I-Dialogos : Déclin d’une certaine conception de la Francophonie ou déclin de l’infuence française ?
Charles Josselin : Force est de constater que l’Afrique se détourne progressivement de la France. Après le Sahel, je crains que l'Organisation de la francophonie, de même que les autres institutions comme l'Université Senghor, fassent les frais de cette évolution, Burkina Faso, Niger et Mali ayant fait le choix de quitter l’OIF considérée comme l’agent d’influence de Paris.
Deux autres institutions pourraient néanmoins conserver leur légitimité. C’est le cas de l‘AIMF, l’Association Internationale des Maires Francophones, et de l’Agence Universitaire de la Francophonie aujourd’hui dirigée par un brillant universitaire tunisien, le Professeur Slim Khalbous. L’AUF a une existence propre. Elle peut même, avec l’AIMF, continuer à alimenter cette grande idée qu’est la Coopération Décentralisée. Celle-ci, pourtant plébiscitée en Afrique, est négligée par notre Diplomatie. Elle est aussi particulièrement affectée par les ruptures politiques intervenues en Afrique. Je pense, par association d'idées, au désastre que connaît actuellement Haïti où on parlait encore français la dernière fois que je suis allé, il y a quelques années déjà.

16 juillet 1993 : Charles Josselin signe un Accord de Coopération Décentralisée Franco-tuniso-polonais
à Olsztyn, en Pologne, avec le Gouverneur de Gabes et le Voïvode de Warmie-Mazurue
L’OIF, c’est budgétairement parlant, essentiellement la France pour près de 50%. Le problème, c’est donc bien la disproportion entre l'étendue supposée du monde francophone et la position réelle de la France à l'international, même avec une arme nucléaire dont j'ai toujours dénoncé le principe et l'inefficacité diplomatique.
I-Dialogos : La dissuasion atomique française n’est elle pas pourtant ce qui permet à la France un positionnement diplomatique bien au-delà de son poids géopolitique réel ?
Charles Josselin : La charge, et pas seulement financière, est trop lourde pour notre pays. Ce point de vue n’est pas nouveau. Plus jeune, j’ai manifesté contre les essais nucléaires dans le Pacifique avec la « bataillon de la Paix ». C'était en 1973. Je reste aujourd’hui encore totalement opposé à cette fuite en avant, à cet empressement guerrier qui s’accentue et ne correspond plus aux réalités militaro-diplomatiques.
J’observe d’ailleurs que la menace nucléaire est de moins en moins évoquée par les commentateurs, y compris les experts militaires de plus en plus présents à la télévision. Comment ainsi ne pas s’interroger sur ces vagues de consultants, ces anciens ambassadeurs recrutés par nos chaînes TV, publiques autant que privées, comme le furent les médecins « consultants » omni présents à l’époque du COVID ? Ce sont ces mêmes experts qui n’avaient pas vu venir l’élection de Trump. Je ne parle pas de ceux qui participent à la vente de nos canons et autres matériels militaires. 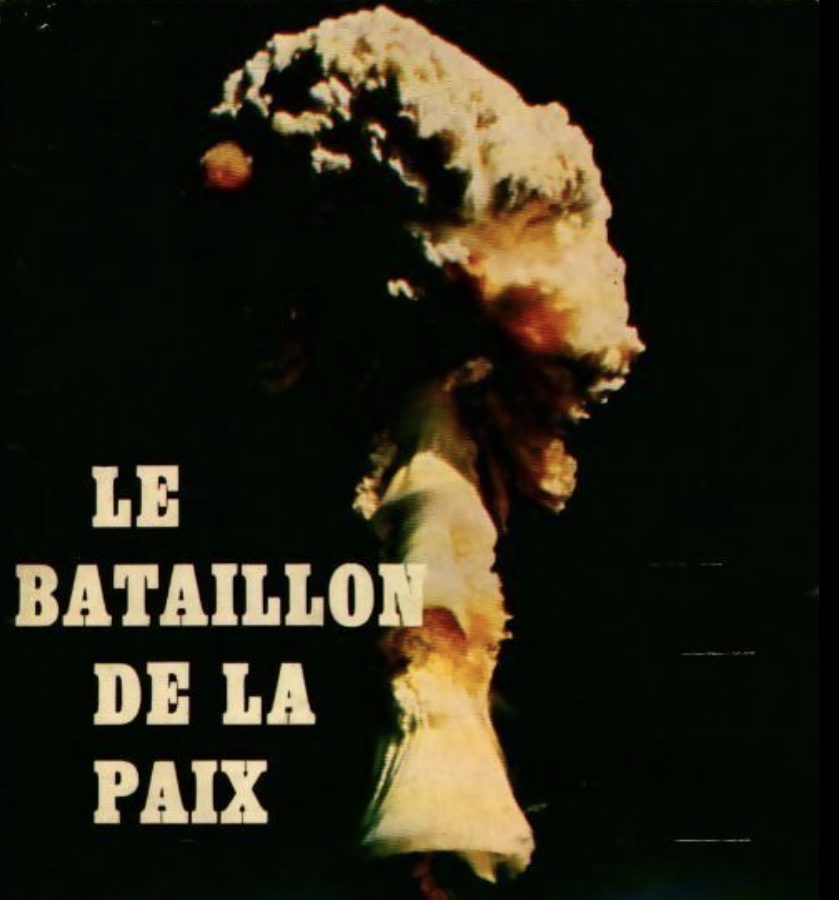
I-Dialogos : N'y a-t-il pas aussi un recul de la Diplomatie ?
Je crois toujours au pacifisme, même romantique, et donc, surtout, à la Diplomatie, pour bâtir un monde vivable. Les mêmes experts consultants, ceux du monde des "neocons" – neo conservateurs - comme on les appelle aux Etats-Unis, désormais en vogue à Paris, assimileront probablement mon approche à de la naïveté...
J’ai cependant la faiblesse de croire encore en la vertu.
Comment ne pas réagir face aux propos de cet ancien général affirmant sans la moindre objection, que l’état normal d’une société, c'est la guerre ! Terrible affirmation qui justifie sans doute son choix de carrière.
I-Dialogos : Pour le grand journaliste Jacques Duquesne, le journalisme ce n’est pas dire ce qu’il faut penser, mais raconter et expliquer. On en est de plus en plus loin, probablement à cause de la pression des réseaux sociaux ?
Charles Josselin : N’est ce pas en effet cette super pollution de l'information qui conduit au désordre de la pensée. Dans cette inquiétante situation, une institution, voulue et dirigée par les Etats-Unis, porte en elle cette culture de la guerre, c’est l’OTAN.
Certes l'agression de Poutine contre l’Ukraine, est inexcusable, mais l'Europe et l'OTAN ont ils joué convenablement leur rôle dans l'application des accords de Minsk ? L’action militante de Bruxelles en faveur de l’élargissement de l’Union Européenne n’est pas pour rien non plus dans l’accroissement des tensions.
I-Dialogos : Quel est le principal souvenir que vous conservez de votre fonction de Ministre de la Coopération et du Développement ?
Charles Josselin : La fusion du Ministère de la Coopération avec celui des Affaires Etrangères. C’est le mandat que m’avait confié Lionel Jospin, Premier Ministre, convaincu que c’était la condition de la fin de la « Francafrique », la fin d’une Diplomatie adaptée au « Pré Carré ». Ce fut difficile, Jacques Chirac y était hostile. il fallut l’expliquer aux dirigeants africains.
La politique française de coopération a conservé longtemps un parfum colonial. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment étonnant. Les premiers à s’en occuper furent les anciens de la France d’Outre-Mer.
Je note que les politiques publiques d’aide au développement s'organisent de manière très différente en Allemagne et en France par exemple. Est-ce du fait de l'organisation fédérale de l’Allemagne où le Ministère des Finances n'a pas l'hyper puissance de Bercy en France ?
Ainsi du poids historique de l'Agence française de développement, ex Caisse de coopération, largement dépendante de la Direction du Trésor du puissant Ministère français des Finances alors que l'agence allemande dépend du Ministère du développement. Le déséquilibre est flagrant. Un Etat dans l’Etat ?
Je constate que l’Allemagne n’a pas les difficultés rencontrées en Afrique par la France. Il est vrai que sa défaite, à l’issue de la première guerre mondiale, l’a privé de ses territoires africains et dispensé d’entreprendre sa propre décolonisation. Depuis, c’est l’expansion vers l’Europe de l’Est qui a mobilisé les ambitions de Berlin.
« Chooze Europe » selon Emmanuel Macron, mais Villers-Cotterêts est déjà, m’a-t-on dit, un très beau musée.
act. le 19 août 2025